Gran Torino
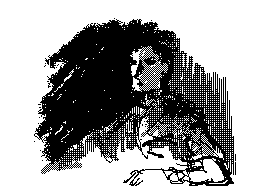
Clint marmonne un truc. Il te déteste et te regarde comme un félin qu’il va égorger à l’aide de ses mains de septuagénaire. C’est dur de vieillir, de se regarder dans un miroir. On peut passer le cap des 70 piges, sombrer dans le gâtisme, devenir un vieux con ou plus banalement se serrer une gogodanceuse parce qu’on s’croit chaud. Clint, lui, n’a pas peur de se regarder droit dans les yeux dans le miroir, de se mettre à nu et en un film, faire le procès tout entier de sa jeunesse.
Comme un “what if” de ce que serait devenu Dirty Harry aujourd’hui, sur un rocking chair, accompagné de son chien, il fusille du regard les passants, les étrangers, sa propre famille de connards (d’ailleurs, sérieux problème de famille, le père Clint, toujours à dépeindre des cloportes qui utilisent et se moquent, la tribu des assistés de Million Dollar Baby est battue à plate couture), personne ne trouve grâce à ses yeux. Il a fait des choses sales dans la vie, mais lui assume en moujik. Il porte ses couilles. Mais ses voisins, chinetoques ou assimilés, pour lui c’est pareil, se feront emmerder par un gang. Des cousins qui veulent engrainer le petit du tier-quar. Et pour ça, ils foutent les pieds sur la pelouse. Sa pelouse.
“Ever notice how you come across somebody once in a while you shouldn’t have fucked with? That’s me.”
Plus linéaire que jamais, Clint nous balance son récit, l’alpha et l’oméga de ce qu’il a été. Mais Gran Torino n’est pas qu’un film avec un vieux qui en met plein des dents aux lascars et aux gangs, ce qui déjà serait pas mal. C’est un défilé de One Liner de fou, de quotes incroyables, toujours à la limite du Dirty Harry mais sans sombrer dans la caricature. Mais alors, wtf; un film de droite ? Pas vraiment. Plutôt un film d’”homme”, un peu comme Rocky Balboa, un autre vieux qui remonte sur le ring. Viscéral et jouissif.

| Print article | This entry was posted by Kamui on 21/02/2009 at 03:32, and is filed under Cinématographe. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed. |

 Follow
Follow
