Cinématographe
Evangelion 1.0 : You are (Not) Alone
Nov 1st

Quand on a déjà prouvé qu’on a révolutionné un genre, pourquoi revenir aux sources à part, bien évidemment, pour la thune ? Evangelion, à la fois gigantesque hold-up créatif et vaste supercherie, n’a pas apporté toutes les réponses exigées par une horde de fans. Donc rebelote, des films résumés.
Flashback et tentative d’initiation pour néophytes. XXème siècle, Gainax pitche une série tout ce qu’il y a de plus classique aux TV japonaises. Des jeunes filles sexy, des robots géants qui donneront une ligne de toys, de quoi rassurer n’importe quel investisseur dans un pays qui produit, non sans classe, des séries de géants d’acier pour distraire les enfants dans les cours d’école et satisfaire les gus amateurs de maquettes, les doigts pleins de colle. Sega (à l’époque plein aux as) et TV Tokyo signent vite. Mais assez vite, la série va partir en sucette. Evangelion est un « bridge drama », expression perso’ désignant ce genre désormais abondamment copié, où la majorité des scènes ne montrent que les relations des personnages principaux entre eux, si possible à bord d’une passerelle de commandement, en restant dans le flou complet concernant les antagonistes). Le héros, Shinji, est mort de trouille et on le comprend : son père l’a foutu à bord d’un de ces Eva pour qu’il protège la Terre déjà passablement décimée. Malheureusement pour lui, son tendre papa est sans doute le géniteur le plus dégueulasse du cosmos, au coude à coude avec Fiodor Karamazov et Joseph Staline. Chaque personnage de ce faux huit-clôt a l’air frappé par le drame et la dépression, le tout généralement en non-dit. Les robots sont aussi tout en métaphores freudiennes super appuyés. Le pire, c’est la fin, comme une montée en épingle pour finir par un dégonflement, génie et grosse arnaque à la fois.
« WEvangelion », la nouvelle série de film est sensé re-raconter la même histoire une énième fois mais différemment. Exercice purement japonais (enfin, moins depuis l’avènement des « minisodes » youtubisés), il consiste à écrémer des tonnes de détails, sucrer tous les moments de latence, sabrer les plans à rallonge… Quel peut-être l’intérêt de démonter une série dont le principe même est de faire monter la pression en épingle, par morcif de 20 minutes, pour qu’elle finisse par exploser à la gueule du spectateur ? Le premier chapitre, « Jô », dit : « You are (Not) Alone », se débrouille pour se bricoler des pics dramatiques aux moments où il faut et des moments de béatitude, le tout en full animation magnifique. Mais 6 épisodes, totalement refait, ça passe à toute berzingue. L’amateur sera étonné du choix des couleurs, des logos refaits, de gros détails qui sautent (les children, au revoir), des images 3D pour les méchants (qui restent toujours volontairement non-charismatique), des Eva presque industrialisés… Cadeau bonux, 30 secondes vraiment inédites pour 2h bien tape-à-l’œil.
Mais les newbies, ceux qui n’ont jamais vu la série, ce qui est officiellement le cœur de cible de ces remakes, ils devront attendre des mois pour la suite ? Il y a de quoi lâcher un gros « mouif ». Evangelion a révolutionné l’animation japonaise et en attendant que quelqu’un se décide à venir déboulonner la statue du commandeur, Gainax et leurs sociétés écrans referont les mêmes tripatouillages (plus que 2 films de résumé et « peut-être » une fin inédite, on retient son souffle, mais longtemps). Un exercice qui ne sert pas à grand chose mais qui a le mérite de rappeler qui est le boss.
Molière (le défi)
Aug 16th
On a du mal à comprendre Molière, ze movie. Peut-être avec un titre un peu plus new-wave tel que « Molière, le combat », ça passerait mieux. Remember, Jean de la Fontaine le défi ! ». Molière made in Duris est vraiment bizarre, perdu entre le what if et le what the fuck, qui ne sait pas trouver sa place, penchant très souvent dans le burlesque grâce à ses acteurs « on fire » qui cabotinent à mort. Ils jouent à la limite de la connivence avec le spectateur, presque en clin d’œil. Durant une période difficile de sa life, Jean-B est en manque d’inspi’ et se retrouve à écrire des vers pour un bourgeois, une véritable inspiration dont on découvrira qu’il est le melting pot des pièces de Molière, l’underdog qui recherche sa street cred’ loin des planches. On ne sent pas l’amour de l’œuvre de JB, et plus des clins d’œil de type name-dropping (une vraie collection d’inventions de dialogue, « La galère », le “sein” etc). Toutes ces répliques authentiquement cultes deviennent des quotes d’appel, un peu comme un rappeur qui place des spéciales casse-dédi pour ses potos, t’as vu. On devine que le résultat ne sera pas aussi haut de gamme (mais plombant) que le précédent film (featuring Caubère), et plutôt calibré 20H30 TF1, ne proposant qu’une vision LOL de Young Molière’s Adventures. Mouaif.
Les fantômes de Goya
Aug 14th
Attention si vous êtes fan de Goya comme oim, vous allez être particulièrement déçu. Voici ce qui sera sans doute le film le plus pipo de 2007, « les fantômes de Goya ». Et pourtant, c’est signé Milos Forman (Man on the moon, Amadeus, Vol au dessus d’un nid de coucou etc ), du bestiaux qui maîtrise les biopics. Pour Goya, faut s’accrocher, parce qu’il n’y en a pas des masses. Il es joué par un suédois déjà habitué à imiter le russe dans Octobre Rouge. Un suédois, un espagnol, un russe, tout ca ne veut plus rien dire quand on tourne en anglais hein ? Mais en fait, lui n’est que spectateur, toute l’intrigue tourne autour de Nathalie Portman, alias l’Actors Studio pour les nuls, qui joue en mode alléatoire. Selon toute vraisemblance, elle arbitrera Intervilles l’année prochaine. La pauvre louloute, trainant dans un Quick de l’époque (circa 1785 or so, l’exactitude n’a pas non plus d’importance) se fait arrêter par la très sainte inquisition. Elle n’avait pas mangé de porcelet et se fait donc torturer jusqu’à ce qu’elle s’avoue juive, rouquine et fan de Tupac. Toute la torture est à l’écran, hein, zéro subtilité comme dans tout le film, sauf quand vient l’abus sexuel de la jeune fille, lourdement suggéré (comprendre qu’il ne manquait plus qu’un bruitage de real-TV ainsi qu’un synthé marqué « Elle se fait violer par Steevie ») par son questionneur, Javier Bardem (sans doute le moins pire de ce freak show, sans rire). Ce dernier sera pris au piège par sa famille et se fera torturer jusqu’à ce qu’il avoue qu’il est le descendant d’un singe. Non là, ce n’est pas une blague, c’est bien le film qui continue. Ah, à propos, que viens faire Goya dans le titre ? Bah il a fait le lien entre la famille de Portman et l’inquisiteur, mais sinon, c’est un lâche assez en retrait, du genre « non, arrête, tu vas avoir des ennuis ». Humilié, l’inquisiteur fuit. 15 ans ont passé, sans que Goya puisse faire sortir sa muse. Bravo. Heureusement vinrent les français mené par Bonaparte.
ATTENTION NOMINATION POUR : SEQUENCE NAZE 2007 Et astuce pour toi, apprenti réalisateur : La guerre va avoir lieu. Il faut montrer le clash, et ce qui se prépare. Des milliers de soldats. L’odeur de la poudre, le bruit des canons et de la guerre, du sang, de l’horreur, des chevaux dans tous les sens. Ca va être le chaos. Il y a tout ça dans « Les fantomes de Goya », quand soudain, la scène cède la place à… Deux poulets qui sautent dans une rue. Oui. Deux putain de poulets. Puis un mec en cheval qui arrive, genre « la guerre est finie, wouhou ». Il faut le voir pour le croire !
Retour en Espagne, Nathalie Portman est libérée. Elle est devenue folle et joue la démence un peu comme (Attention, quart d’heure cinéphile « hommage ») feu Michel Serrault dans Les Rois du gag de Zidi, quand il est sensé sortir d’un souterrain et qu’il n’y a plus âme qui vive sur Terre. Nathalie arrive chez Goya (qui a décidé de resservir un peu, histoire de) et lui annonce qu’elle a donné naissance en prison à une fille qui a donc logiquement autour de 14-15 ans. Notre artiste hispano-suédois la croisera par hasard dans la rue, elle fait le trottoir ! Il n’aura pas de mal à la reconnaître, elle est jouée par Nathalie Portman, elle même ! Et alors là, c’est le cosmo-comble : elle joue plus mal la pute que la folle. Bon dieu, mais quelle folie de casting de lui faire jouer les deux rôles ! Et alors, megaton gigashock, le père de la gosse, l’ex-inquisiteur, revient en révolutionnaire zélé, avec super laïus sur Voltaire et Diderot. On est même plus dans le déni à ce niveau là. Il fout en taule son ex chef, grand maître inquisiteur, Michael Lonsdale, pourtant super mais toujours fouré dans les bons coups de l’église depuis le « Nom de la Rose ».
Bon, pour être sur que vous n’alliez pas voir ce gloubi-boulga incroyable, les anglais s’allient aux espagnols et font fuir les français, le néo-révolutionnaire Bardem est rejugé par l’inquisition remise en place et exécuté en place publique sous les yeux de sa fille Portman et l’ex-taulière Portman. Scène de fin, la folle suit la chariolle qui emmène le cadavre de l’ex-inquisiteur, avec un bébé trouvé par terre dans les bras, tandis que Goya, qui aura autant servi que Francois Fillon dans cette histoire, marche au loin, dépité. Cut. Plus lourdingue, tu meurs.

The Simpsons : the Movie
Aug 10th
C’est au tour des Simpsons de sauter le pas et passer de la TV au ciné. Homer et sa famille pavoise déjà sur l’affiche à la compo bizarrement moche. Un signe ? Les fans de longue date qui voient plus loin que l’aspect simplet gag-sitcom le savent bien : un épisode des Simpsons, c’est une mécanique complexe. On commence une histoire lambda toujours un peu louf’ et qui va durer 2, 3 mn, histoire d’aiguiller le scénario de l’épisode qui n’a en général rien à voir, en incluant au passage quelques persos secondaires, la marque de fabrique de la série. Par exemple, ça débutera sur un Homer qui est sur la tête d’un paquet de lessive japonais et il finit avec le prêtre en train de se faire courser par des singes carnivores et agressifs le long des montagnes russes. Ca, c’est un exemple type de narration Simpsonesque. Le movie (le premier, vu le succès, puisque les gens « acceptent de payer pour voir au ciné ce qu’ils regardent déjà à la TV » dixit la vanne de Homer au début) se retrouve réduit à l’état de simple sitcom : il plante son histoire et continue à dérouler son train-train sur un monorail en essayant d’aligner un rire/blagouse toutes les 30 secondes. Mais pas toujours, la version longue se permet de faire des interludes larmoyants et sentimentaux, si rares et brefs dans la séries qu’ils donnent ici l’impression de durer des plombes. Mais en plus, en se centrant sur la famille, le long oublie complètement ce qui fait le charme de la série, à savoir le supporting cast, Burns, le flic, le proviseur, le marchand de comics, ils en sont tous réduit, au mieux, au rang de caméo. Ha ha dirait l’autre. Du coup, on obtient un film au mécanisme Disney, avec un gout de morale à la noix. Pire, certaines ficelles ne sont même pas drôles et sont même attristantes. Bart, tentant de se rapprocher de Flanders au cours d’un trèèès long sous-scénario, finit par prier Dieu à l’Eglise avec lui. Le gosse le plus connu et décadent des USA est-il ici drôle ? Emouvant ? Pathétique ? Même le Itchi & Scratchy, jouant sur la mégalo, n’a déclenché que des rires gênés. Comme un long épisode très moyen, qui prends le luxe de piocher dans ce qu’il y a eu de plus moyen dans la série en se permettant même d’être bien pensant. Mega bof.
Hot Fuzz
Aug 4th
Deuxième film de la dream team de Shaun of the Dead. Dire qu’il est plus abouti reviendrait à marquer sa préférence pour les buddy movie, mais c’est pourtant l’évidence. Shaun, après un début en fanfare retombait dans le film de zombies conventionnel. Les limites de la satire. Hot Fuzz choisit de rester dans le pastiche du début jusqu’à la fin. Du coup, on retrouve la “brit-touch”, cette inventivité dans les personnages secondaires, les sub-characters truculents sans être too much ou gavant. L’histoire est même à la limite du pamphlet sociétal, me moquant des clichés du terroir, des villages comme à l’ancienne sur fond de musique Herta. Les bonnes valeurs de la campagne, notre héros va se les prendre en pleine face. Muté pour excès de zèle, il se retrouve dans la bourgade typique Jean-Pierre Pernault à l’English, le coin qui vote comme on lui dit à la TV et où la kermesse rurale est l’événement le plus important de l’année. Après une longue mise en place, le héros va se faire un pote dans son commissariat. Fan de buddy-movie, il va l’initier dans tout ce qu’il y a de cool dans le fait de plonger en canardant, un gun dans chaque main. Les années 80, quoi. Le pastiche devient alors hommage cynique et rigolo, et nous rappelle, si besoin était, à quel point les comédies d’un tel niveau sont tout simplement impossibles en France.
Plaisir hormonal logique de cinéphile, Hot Fuzz se choppe pas moins de
 sur 5 dans le grand barème de la coolitude Airwolf.
sur 5 dans le grand barème de la coolitude Airwolf.
Anna M.
Jul 31st
Anna M. est flippante en érotomane. Elle s’amourache d’un docteur qui n’a rien demandé (Gilbert Melki, a.k.a le Pacino français). Mais pas genre un peu, la bonne grave malade mythomane. Petit à petit, à coups de crises foudroyantes, elle bascule dans la folie furieuse, bien violente. Le setup a tout d’un téléfilm M6 si la malade n’était pas joué par la sensationnelle Isabelle Carré, inouïe de justesse dans l’escalade de sa folie. C’est sans doute l’irrationalité la mieux rendue depuis la « femme à la chouette » dans Twin Peaks, mais toujours en restant ancré dans un réalisme quasi-médical. Cet effroi survit même à une fin un peu pipo qui, forcement, prend soin de désamorcer la folie pour éviter que les gens fassent des cauchemars.
Death Proof
Jul 25th
On pourrait résumer le cinéma de Tarantino à des gens habillés un peu retro qui badinent sur de la pop culture en fumant des clopes (si possible de belles femmes hargneuses), suivi d’une fusillade ou d’une baston. Du cinoche totalement futile, pop-corn grand format et explosions, jubilatoire, quasi primaire mais limité. On restait dans l’anecdotique et la pertinence d’un remake. Death Proof est aussi malicieux que ses prédécesseurs, sinon plus, car mieux maitrisé. Astucieux, il évacue sa tarantinerie gentiment crâneuse dans une première partie pur sucre, pour basculer dans la thèse antithèse des scènes de courses des années 70. Bobine cracra, fausses bandes annonce (pas en Europe), problème de projo, tout est fait pour y croire. Tel un lego, Tarantino construit quelque chose, l’essore et le recrache, pour faire une espèce de film viscéral, qui prends aux tripes et dont on sort en remuant les bras en l’air de bonheur. Au passage, son avenir de DJ est toujours autant assuré, en « providant » une bande son assez exceptionnelle qui ne manquera pas d’être repiquée dans des pubs ou dans les futurs sujets de Confessions intimes. Jouissif, hormonalement chargé et totalement décompléxé, Death Proof récolte donc logiquement un

sur 5 sur le barème altercinéphilique Airwolf. Du cinoche sous amphet rigolo.
Live free or Die Hard
Jul 18th
Les USA se retrouvent paralysés à la suite d’un piratage massif. On y croit. Ca n’a rien d’un huit clos, mais McClane revient quand même à la charge, il est vénère et à la limite du masochisme. Il s’attaque à un hélicoptère, un jet ultra high tech qui fait du surplace en vol vertical, il fait tout, même du buddymovisme avec son petit pote de la génération ipod internet. Mais l’histoire est si nawak on n’y croit plus beaucoup. Willis non plus d’ailleurs, il cachetonne dans ce film improbable qui pousse le luxe jusqu’à proposer un grand méchant non charismatique. Non, c’est pire que ça, le némesis de McClane n’est autre que le sosie vivant de Bénabar, qui a eu la bonne idée de mettre une webcam au dessus de son arsenal d’ordinateurs, histoire qu’on voit sa tête si des fois, un gus venait à hacker son système. Très bien pensé, Bénabar, mais valait mieux qu’il reste chez toi avec ta meuf pour te faire des pâtes. Même Kevin Smith qui joue l’otak’ survitaminé gatorade fait totalement rajouté, comme un clin d’œil poussif, tant d’éléments non dynamique que même Wiseman ne peut sauver. Die Hard quatro est un peu le Hyppopotamus de l’actioner de l’été. C’est totalement ringard, les catchlines sont téléphonées, les acteurs n’y croient pas et même l’histoire ne croit pas en elle-même, mais on se maintient à l’état du minimum syndical, celui du steak haché frites (et du surgelé en plus !). Avec son rating pour gosses, plat comme une crêpe et fade comme du tofu nature, la licence va pouvoir mourir en paix maintenant.
Note Airwolf (sur 5): 
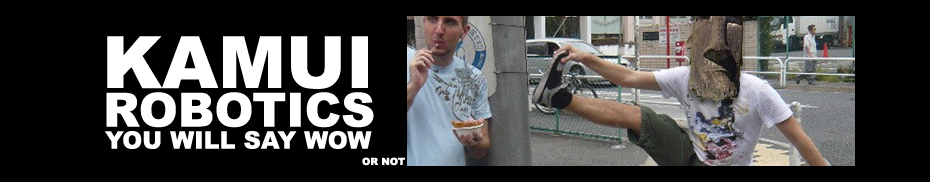
 Follow
Follow


Com-Robot