Robin Hood
 Ce que j’aime chez Ridley Scott, c’est que c’est un vieux qui réalise des actionneurs. Bientôt 73 ans, le mec. A cet âge là, les vieux cherchent à vivre en Suisse ou un quelconque endroit chiant du globe. Ridley, il ne profite pas de sa retraite. Tous les 10 ans, il te balance un film qui repose les bases de son propre genre, l’Histoire sous testostérone.
Ce que j’aime chez Ridley Scott, c’est que c’est un vieux qui réalise des actionneurs. Bientôt 73 ans, le mec. A cet âge là, les vieux cherchent à vivre en Suisse ou un quelconque endroit chiant du globe. Ridley, il ne profite pas de sa retraite. Tous les 10 ans, il te balance un film qui repose les bases de son propre genre, l’Histoire sous testostérone.
Tous le monde (ou presque ?) est d’accord pour dire que Gladiator a réécrit la charte du cool qui en excluait les films de glaives avec mecs en jupettes. Moins léger, moins luisant, le gladiateur de Scott avait enfin le droit d’être sale et traumatisé tout en trucidant du lion dans l’arène. Unleash hell, tout ça. Il a airwolfisé le genre.
Ce “Robin Special Origines” s’intéresse à une période peu classique du canon traditionnel. De son retour de croisades au début de la clandestinité, il fait de lui le parrain et mentor de la Magna Carta. Un rôle de Martin Guerre, bien lourd et profond, zones de gris inside. Bref, tout qui justifie la torse-nudité de Russel Crowe vers la moitié du film. Russel convient parfaitement au schéma Scott qui a besoin d’un mec viril, tourmenté, drôle mais sans traces d’émo. Kingdom of Heaven, qui n’est finalement qu’un prélude de ce Robin Hood, n’avait que trop souffert de son Orlando Bloom. Mauvais choix de gus rendu évident par les scènes de de speach bien viril pour motiver des milliers de soldats condamnés à une mort certaine. Avec Russel, pas de soucis, l’autorité couillue, elle est dans la place, quitte à rajouter facile 80 kilos à l’archétype Errol Flynn. Prends-en de la graine, Orlando.
Mais il ne serait rien sans quelques seconds roles charismatiques. Un bon actionneur, ça tient à des némesis forts, et là, il y en a plusieurs. Mark Strong sort une exquise compo d’arrogance qui se la joue faux-français (ouais, c’est justifié par le scénario). Template du bad guy british réutilisé à tout va par Hollywood, 2010 est son année (check Sherlock Holmes et Kick-Ass). Rajoutez des mecs ultra-charismatiques à la Jeremy Irons, ici ce sera William Hurt. Superbe. Mais il faut toujours un vieux érudit charismatique de 173 ans, doté d’un permis shakespearien, mais qui meurt généralement le temps que sorte le film. Coup de bol, Max Von Sydow emmerde les superstitions et joue justement un des meilleurs vieux plein de sagesse du ciné d’action aux côtés d’Oliver Reed, Alec Guiness, Lawrence Olivier et Sean Connery.
Heureusement qu’il y a un paquet de français, délicieusement fourbes comme il se doit. Spécial petit rôle à Denis Menochet, le français du début de Inglorious Basterds. Et heureusement, Léa Seydoux a suffisamment de screen time pour nous faire oublier Cate Blanchett. Bon. Cate. Faudra qu’on m’explique. La preuve irréfutable qu’elle est en train de se formoliser : tous s’accordent à dire que c’est une actrice sans faille sans jamais pouvoir namedropper un seul bon film. Ok, c’est exagéré mais vraiment, Robin revient dans un pays qui s’est littéralement fait émasculer après des dizaines d’années de guerres et de croisades. Un pays de meufs. Et il chope Cate Blanchett, vraiment ?
Bourré d’anachronismes qui feront la joie des wikipedistes, Robin Hood ne réinvente même pas son propre genre. Sa structure linéaire le rend assez binaire, slashé comme d’habitude par le montage abrupt d’une prod Scott. Il se contente de dérouler un programme qui plaira aux amatrices de pecs’ et aux fans de grand bruit. Cheval blanc, masse à la main, Robin ne tirera que peu de flèches, lui préférant une recherche pas méga subtile du père de substitution, une catharsis sans problème pour Russel, habitué aux chefs d’œuvre tourmentés du genre Master & Commander. De l’entertainement qui sent bon la cotte de mailles. Mais le vrai sujet du film, c’est Ridley Scott, l’inventeur du director’s cut, qui démontre qu’il n’y a pas de fatalisme dans la vieillesse. Cheers.
Rien que pour ça,et parce qu’il ne se la coule pas douce en Suisse :
| Print article | This entry was posted by Kamui on 14/05/2010 at 14:28, and is filed under Cinématographe. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
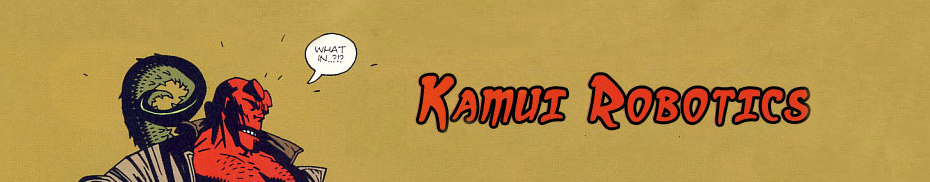

 Follow
Follow









