Posts tagged Spielberg

Tintin: le secret de la Licorne (VS les Schtroumpfs)
Oct 19th
Le meilleur moment, dans un film d’action, c’est quand un chinois se laisse glisser en donnant des coups de pied. Quand ça arrive, je vibre. Et à un moment, Tintin fait “presque” ça. Ce qui en fait une réussite et le meilleur film 3D non-Pixar since ever. Mais histoire de faire monter le désir de Tintin, on va commencer par son cousin germain franco-belge, les Schtroumpfs, sorti cet été..
Je me souviens d’un webcomic qui dessinait un sinistre businessman faisait caca (littéralement) sur ses souvenirs de gosse. Soit. Le problème, c’est qu’aujourd’hui, il est impossible d’avoir une seule et même voix sur un personnage. J’aime passionnément Batman. Et je sais pertinemment qu’il apparait dans 10 comics par mois, un ou deux dessins animés, parfois un film. Et c’est sans parler des différents jeux. Avec des résultats vraiment inégaux. Faut l’accepter, avec une pensée pour les néo-parents, les tontons et les tatas qui emmènent les petits en se disant qu’il faudra supporter deux heures interminables. Un jour, ces mômes leur revaudront ça. On finit toujours par comprendre ce qu’on inflige à ses parents. Genre, le film Musclor & She-Ra au ciné, j’essaye encore de me faire pardonner.
La version Hanna Barbera était déjà une adaptation un peu libérale de la bédé (quoique le studio a quand même fait un épisode basé sur Le Schtroumpfissime, le meilleur album, le plus sensible. Mais last time I checked, Gargamel y avait un apprenti du nom de Scrupule.
Le film reprend grosso modo la trame d’un Alvin & les Chipmunks (…) où les Schtroumpfs vont se retrouver téléportés par accident à New York, poursuivi par un Gargamel en feu, incarné par un mec qui donne tout ce qu’il a, à la manière d’un Franck Dubosc.
Non, the Smurfs n’est pas la pire adaptation de l’humanité, elle reprend même plutôt bien l’esprit de la version Hanna Barbera. En l’occurrence, c’est même assez touchant de voir autant de talents (genre Neil Patrick Harris) se débattent pour que le film tienne un peu la route. La manière dont est présenté le Grand Schtroumpf montre qu’ils se sont quand même posés quelques questions quand au fonctionnement de la bédé et puis la scène de fin est même assez habile, quand tous les Schtroumpfs luttent à l’unisson.
Le méta, inévitable pour un film qui passe du pays des Schtroumpfs à New York est la touche bizarre. Et je parle d’un film avec des lutins bleus qui se baladent à Central Park. Gargamel qui, par exemple, demande au spectateur “si ce n’est pas bizarre, un village avec 99 garçons et une fille” est à ranger au rang des phrases de trop, tandis que Neil Patrick Harris s’interroge gravement: les Schtroumpfs naissent-ils avec leur talent et donc leur nom, ou bien est-ce qu’on leur donne un nom quand on finit par trouver leur particularité ? La chanson des Schtroumpfs devient en elle même un gag car trop prise de tête.
La vraie trouvaille, bien méta elle aussi, c’est le “Schtroumpf Narrateur” qui commente littéralement le début et la fin de l’histoire. Quelle idée de génie…
Ca sera un
The Smurfs essaye trop d’être kawaii au lieu d’être rigolo et astucieux mais ce n’est clairement pas la daube forcément condamné d’avance.
J’aurai bien placé une spéciale pour l’élève Ducobu (vu aussi, adapt 100% française par contre) mais ça attendra. Remember, Adèle Blanc-sec. Autre planète, autre parti pris.
Tintin, le film de Steven Spielberg a choisi de ne pas choisir. L’historie commence bien à Bruxelles “il y a quelques années”, où tout s’enchaine à la découverte à une brocante d’un modèle réduit d’une Licorne. Certes, Tintin ne l’offre pas à Haddock dans ce pur acte de bromance car, hé, il ne le connait pas encore, son Archibald Haddock.
On aurait pu croire que Hergé et Spielberg (le producteur de Transformers, celui qui nous a abandonné avec Indy IV, “tu sais le film qui n’existe pas”), ça allait être un clash, genre Two Worlds collide. Pas du tout. Tintin : le secret de la Licorne absorbe complètement les albums de Tintin, son design mais aussi son héritage sans aucun droit d’inventaire. Pas de téléphone portable, pas d’internet, un monde désormais rétro où roulent encore des side-cars.
La ligne claire est carrément sublimée par le mouvement de la 3D. Que l’action ralentisse lors de la géniale scène de traversée du désert (“Le Crabe aux pinces d’or”, un de mes 3 albums préférés a été complètement dénoyauté pour s’adapter à la structure “du Secret”) ou quand elle accèlère d’un coup de flashback fluide et alcoolisé de Haddock, la CG transcende complètement ce qu’on a pu voir dans les différents trailers. Il n’y a guère que l’ultime clash contre ce némésis réinventé pour l’occasion qui trahit le besoin (et la necessité) de construire un climax à l’hollywoodienne. Tant pis.
Il faut que je te parle de cette scène d’action. LA scène du film. Le secret de la licorne devient vraiment génial quand il sort carrément du carcan de l’original pour se faire l’écho des courses poursuites d’Indiana Jones. Tintin est le roublard, Haddock est le novice, le Henry Jones Sr, celui qui tire à l’envers quand tu lui donnes un gun ou un bazooka. Tu le sais sans doute, j’ai vu tous les actionners de l’été et le sujet me passionne. Mais Tintin a, sans plaisanter, la plus belle scène d’action de l’année. Hergé n’y aurait rien renié, lui qui savait faire des planches au dynamisme de maboul quand il s’agissait de représenter le chaos. Je crois que cela se joue dans la trajectoire des personnages qui donne une vraie sensation de fluidité qui m’évoque, dans ses meilleurs passages, des films vénères comme Time & Tide. D’où les chinois qui glissent sur le sol.
En voyant Final Fantasy Spirit Within, je m’étais dit “pourquoi s’emmerder avec des acteurs quand on peut utiliser leur apparence, figée dans le temps comme le meilleur botox. 10 ans plus tard, cette démo a fait renaître l’envie de voir un Indy IV contre des nazis, tout en CG. En plus je suis certain que Harrison Ford est devenu trop relou, un peu comme Bacri, à jouer le grincheux toute sa vie. Enfin, j’imagine, mais le problème ne se posera pas avec un modèle 3D.
Oublié Indiana Jones IV (qui n’a pas existé, on est tous d’accord). Big up Tintin, tu as donné l’occasion à Spielberg de mouiller le maillot à nouveau, de signer son meilleur film d’aventure de Spielberg depuis la Dernière Croisade. On en avait bien besoin, là, maintenant.

Super 8
Jul 16th
Qu’est-ce qui fait de Super 8 un blockbuster ? Le fait qu’à un moment, ça explose de partout ? Un budget conséquent et une sortie événementielle soit la garantie de se refaire après une campagne promo soutenue ? Ou alors simplement parce qu’il se veut film de genre, à la Cloverfield, au pitch débilement caché par le truchement des campagnes des internets. Ou alors simplement par la volonté de Bad Robot (bientôt Mission Impossible 4 par Brad Bird, can’t wait), en pleine montée en force au rang des powerhouse du divertissement ?
Sur l’échiquier des blockbusters de l’été, Super 8 trouve sa place à la case inattendue, celle de la tendresse, quand il essaye de restituer les sensations des films de Spielberg early 1980, principalement Goonies et E.T. J’ai du mal à le croire, mais le genre tout entier est devenu un film d’époque qui nécessite un soin particulier pour qu’il fonctionne. Il faut voir avec quelle délicatesse Super 8 évite de transformer chaque réplique en time dropping éprouvant, laissant les éléments extérieurs se greffer, imprégner la péloche, qu’apparaisse, comme à l’époque, la même vision de l’Amérique pavillonnaire de l’époque qui cache des chambres d’ado remplies de goodies de l’époque, avec Spielberg en statue du grand co-producteur de son propre mythe.
Super 8 est aussi de très loin le blockbuster le plus tactile de la saison, celui de la transition. Le garçon central du film est endeuillé par la mort de sa mère et s’accroche (carrément physiquement) à son portrait dans un médaillon, comme un doudou transitionnel. De cet élément découlera toute une série d’éléments symboliques aussi touchants que simplets dans un film où chaque contact, main contre main, main sur la joue, où chaque embrassade semble donner des frissons télépathiques.
Il y flotte comme une odeur de niaiserie quasi cool, pas bien méchante, celle des années 80 où l’on pouvait se permettre n’importe quoi. A jouer sur les sentiments bien plus que sur la logique de ses personnages, Super 8 finit par évoquer les mêmes défauts inhérents aux productions Amblin, les inévitables militaires caricaturaux en ultime barrière, les éléments adultes déboulant pour un final bateau et passe-partout au clair de Lune. L’hommage à Spielberg va jusque là. Sur sa bonne lancée, Abrams signe là un blockbuster léger comme un vélo qui s’envole. Précisément ce qu’il fallait pour un blockbuster mélancolique d’un genre passé.
The Adventures of Tintin
Nov 1st 12:44


 Joli mais *fear* quand même.
Joli mais *fear* quand même. Transformers
Jul 16th

Kro Kru Kri Kri. Voilà 22-23 ans que ce bruitage hante mon esprit, la mélodie métallique que faisaient les Transformers, un des dessins animé les plus classe du cosmos. Résumé de l’idée de base : des robots gentils (les Autobots) poursuivis par leurs némésis (les Decepticons), s’écrasaient sur Terre où ils continueront leur guerre. Particularité, ils sont transformables. Comme toutes les séries des années 80 imaginées autour d’un concept-roi (=> dont le pitch est suffisamment fort pour ne faire qu’une ligne ou deux, tout en restant suffisamment puissant), ce qui est cool, c’est la robotique. Franchement, à quoi bon s’être farci Tonnerre Mécanique, K2000, Supercopter ou même Jayce et les Conquérants de la lumière si ce n’est pour la classe des caisses ou des engins ? En l’occurrence, tout le scénario et le background a été développé autour de jouets… Transformers avait aussi le bon goût d’avoir globalement assez peu de contact avec les humains. C’était surtout au cours des combats que l’histoire se permettait de développer les caractères de chacun des robots. Déjà, ils avaient tout compris ! Pas de perte de temps !
2007, les américains récupèrent les droits et tri-dimentionnalisent un univers volontairement binaire et cool. Aux commandes, Spielberg (bientôt Tintin en CG) et Michael Bay, qui ne peut pas filmer une voiture qui fait un créneau sans faire un parcmètre qui explose. On est en droit d’avoir peur. Il faut adapter un dessin animé de garçons en massive blockbuster de l’été, il faudra s’adapter aux codes. Tranformers 2K7 est assez rassurant dans la mesure où cette version a conçue selon le principe « qu’est-ce qu’on peut garder » au lieu du triste « bon, faut modifier tout ce qu’on peut » (et là, on pense tous Daredevil). Optimus Prime est bien le chef charismatique qu’il a toujours été, poussant le mimétisme jusqu’à quoter ses répliques les plus cultes (« One shall stand… »). Megatron n’est plus un gun mais un jet de l’espace. Les transformations ont été repensées pour garder une logique de masse. Fini donc Soundwave gigantesque qui devient un radiocassette de la taille d’un Kinder Surprise. Une croix de plus dans la checklist des concessions.
Revenons à « Kro Kru Kri Kri » qu’on entend, parfois, pas systématiquement. C’est un peu la madeleine, le crédit donné aux fans qui viendront crier leur passion ou leur haine du film sur internet qui verront leur nostalgie glissant sur la pente du >LOL PTDR<. Transformers est donc devenu un objet « entertainement », un peu comme la Wii a dérivé hors de la sphère jeu vidéo pour devenir autre chose. Shia Labeouf est le Tintin du robot et s’en sort pas trop mal d’ailleurs, tout comme Meggan Fox (ouch, ze bimbo de l’année, accrochez-vous) tandis qu’on appréciera des petites perfs de « Sucraaay » de Prison Break et d’Aaron Pierce, le highlander de 24. A noter la composition de John Turturro qui joue un mec du FBI comme s’il était dans un film des frères Cohen, totalement lunatique et improbable. Il est d’ailleurs le seul qui cabotine vraiment, car ils jouent tous de manière assez sérieuse en évitant aussi l’effet écran bleue à la Star Wars (« bon, là, vous regardez par là et vous imaginez qu’une galaxie explose devant vous »). Quand TF version Bay ne fait pas exploser des trucs, on est dans de la dramaturgie « sauvé par le gong », oscillant entre dérision et le « on me la fait pas, à moi », en beaucoup moins agressif que Spider-Man et X-Men. C’est sa principale qualité, il ne se moque pas du concept, il y va à fond, sans se poser de questions. On pourra regretter ces petits passages Spielberg 80’à la « vite, cache E.T dans la boite des jouets ! », très ringard. Mais pour être l’évènement de l’été, il faut que ça putain de blaste comme dit Lord Jean-Marc. Les Decepticons sont binairement méchant comme il faut et cassent tout, sans pitié. L’arrivée de Devastator est assez géniale dans le genre qu’on pardonne les histoires de cube cosmique qui donne vie à des ipods et ses petits robots méchants comme des gremlins.
Transformers sera donc au mieux un actioner standard, une espèce de checklist complète par des artisans calibrés, on peut difficilement enlever ça à Bay, un machin qui fait énormément de bruits (attention au premier rang !). Au pire, ce sera aussi agréable à regarder qu’un épisode d’Airwolf et ses scénarios plan-plan jusqu’à ce qu’arrive les séquences de dégommages de communistes en hélicoptère qu’on attend tous. Transformers est un film des années 80 où l’on a collé des scènes de baston kaboum qui claquent et des trucs qui explosent.
C’est l’occasion d’inaugurer un système spécial de notation pour ce type de films.
Note Airwolf (sur 5): 
Munich
Feb 9th

Le film le plus ambitieux de Spielberg depuis extrêmement longtemps. Après l’improbable Guerre des Mondes et le pathétique Terminal, voilà un objet courageux de la part du réalisateur à la filmo en montagnes russes. Munich est intriguant. Ce n’est certainement pas pour sa rigueur historique (c’est une fiction basée sur des faits réels). Le rôle joué par Bana, celui de l’espion exécuteur qui a des états d’âme n’est vraiment pas plausible. Un mec qui aurait passé toute sa vie au Mossad, un mec formé à ça, baignant dans un patriotisme sûrement alimenté par son père héros de guerre, qu’il se prend d’états d’âme à mi-parcours parait quelque peu fort de café. Toute l’organisation de renseignement (Michael Lonsdale, brillant comme d’habitude), perdue quelque part dans le Périgord, qui serait mieux informé que la CIA et le KGB réunis… voyons… à qui veut-on faire croire ça ? Le pire, c’est sans doute ses clichés qui vous éclatent à la gueule… On est à Paris, on s’assoit dans un taxi, hop y’a Piaf. Pour bien qu’on soit sûr. Des petites cartes postales comme ça, y’en a pendant tout le film. Lorsque vient la Hollande, c’est limite des gars à vélo qui transportent du gouda.
Alors quid ? Hé bien, cela fonctionne comme un honnête polar sans pic à atteindre, les personnages tous bien typés pour, à un moment ou un autre sortir un laïus. Kasso sort un truc idéaliste, le futur James Bond qui joue dedans est un va-t-en guerre. Même Golda Meir y va de sa phrase imparable. Mais il y a une scène assez grandiose que je m’interdirais de vous spoiler ici, un flash, une vraie bonne idée qui porte un peu tout le propos du film. Peut-être que par les temps qui courent, mettre dos à dos espions israéliens et terroristes palestiniens n’est pas une idée judicieuse. Mais ça donne l’occasion à Spielberg de produire un vrai film noir et dur, avec un résultat plutôt positif. Bana est bon, avec enfin un film à la mesure de son talent. Et quelqu’un qui filme Marie-Josée Croze (quels seins!) nue ne peut qu’être une personne de bon goût.
La guerre des mondes
Jul 9th

Hormis les Jules Vernes, La Guerre des Mondes est mon livre de SF préféré. Je me souviens avec précision quand, enfant, j’ai découvert ce chef d’œuvre, dans une édition un peu viellotte, décorée des savantes illustrations d’Edgar P Jacobs (un kitch certain quand on est habitué dès l’enfance à des robots du type Capitaine Flam et Ulysse 31). Dans la même collection, il y avait même mon autre bouquin de SF préféré, la Machine à remonter le temps. Mais revenons à La guerre des Mondes dont la Spielbergisation vient de sortir. Déjà cela consiste à transposer l’action, l’ère victorienne dans toute sa classe, au monde contemporain. Evidement. Les gens n’auraient pas compris le danger si c’est des calèches qui se renversent. Mais déjà je tilte. Pourquoi transposer l’action ? Le bouquin de Wells fonctionne parfaitement à son époque car il est libéré des contingences que lui imposerait le monde d’aujourd’hui. Pas de tunnel souterrain, pas de satellites ou de super télescopes qui détecteraient les envahisseurs, etc… La version de Spielberg élude toutes ses questions qui pourtant paraissent logique. Par exemple (dans un autre genre) Goldorak (que tout le monde connaît) s’il était transposé dans un monde réaliste d’aujourd’hui, serait détecté tout de suite par un satellite de surveillance de Vega, qu’il prenne la cascade ou la route numéro 7. La fin par exemple était totalement logique lorsque le bouquin a été publié, mais aujourd’hui, franchement, je doute, quoiqu’elle est toujours aussi ironique… Peut-être un des points le plus respectés du film. Mais voilà, blockbuster oblige, on transpose.
Vient ensuite Tom Cruise, à la non crédibilité hallucinante. Mon dieu… Il joue un peu comme dans la première scène du dernier samurai, ricanant, horripilant, on sort littéralement du film quand on le voit. Qui croit à un seul moment en son rôle de père divorcé, travaillant dans les docks, roulant en super caisse de frimeur ? Et je ne vous dis pas quand il pousse la chansonnette. On a bien rit. Et c’est bien ennuyeux car dans Minority Report, il était assez en retenue. Mais visiblement la tragique étape The Terminal n’est pas encore digérée. La fillette s’en sort plutôt bien, crispante comme pas permis, ce qui est, je suppose l’objectif à atteindre. Mais voilà, y’a pas de petite fille dans le bouquin. Le mec, il va chercher sa femme, pas des mouflets. Tim Robbins est pas mal, flippant comme il sait l’être malgré une entrée tendance Bella Lugosi. Certaines scènes sont vraiment hallucinantes de mollesse (la scène de la terre qui se creuse et s’écarte, avec des figurants qui semblent s’éloigner au “top” du réalisateur, comme des danseurs, à droite et à gauche de la faille. Mais que se passe-t-il, Steven ?!).
Le parti pris de la guerre cosmique en toile de fond est sinon plutôt intéressant, cette bataille avec les tanks et les hélicos terriens dont on ne voit pas le résultat. Déjà fait dans le risible Signs, mais c’est toujours intéressant. Ca fait penser à un dessin de Gotlieb, un canon en gros plan enorme, cachant une guerre immense, ne laissant émerger au loin que quelques escarmouches visibles avec comme commentaire “la terrifiante bataille de Waterloo”. Ah oui, dans le bouquin, les martiens déboulent pour coloniser la Terre, car leur monde est devenu invivable. Métaphore des guerres coloniales de l’époque, Wells, gauchiste et anticlérical à une époque où cela signifiait vraiment quelque chose et demandait du courage par paquet de douze, condamnait le monde moderne qui avilissait l’Afrique, l’inde et le reste du globe. Ici, faut pas chercher, les ET, c’est le mal, c’est Al Quaïda et tutti quanti. Spielberg est intelligent (j’avoue même aimer Amistad) mais là y’a un truc qui cloche, un cahier des charges de Cruise ? Les martiens ont été “independance dayisé” (ou Evangelionisé comme on dit chez les amateurs de dessins animés japonais). Bon voilà, ce Guerre des mondes m’a rendu triste. Quel bouquin fantastique quand même.
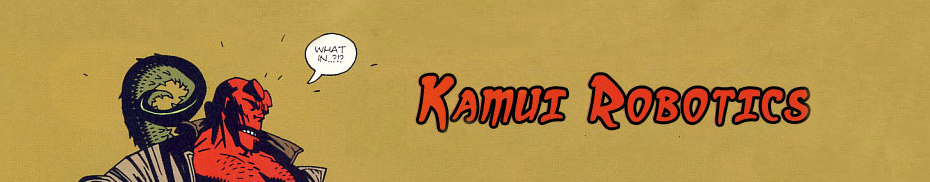


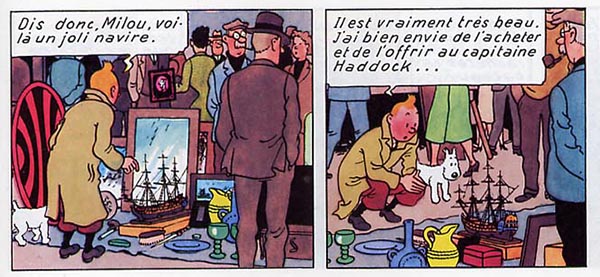





Com-Robot