Posts tagged Pixar
Wreck-it Ralph
Dec 4th
Wreck-it Ralph, “Les mondes de Ralph en vf”, commence par une réinvention jouissive du jeu vidéo comme mythologie. “Qu’arrive-t-il aux héros de jeux vidéo quand on ne les incarne plus ?” Pour répondre à cette question, Wreck-it Ralph se la joue Toy Story : tout un monde parallèle prend vie dès qu’on ne regarde plus les personnages. Les héros des bornes d’arcade se donnent rendez-vous dans un hub gigantesque, une récré où tout le monde est ami. Un début étourdissant comme seul Pixar savait les faire, et cette fabuleuse image de ces petits mercenaires du plaisir qui soufflent enfin à l’idée de ne plus avoir à faire semblant de mourir pour quelques pièces enfournées dans une machine.
Je me souviens m’être fait la réflexion en voyant le superbe générique de fin de Wall-E. Dans une grande fresque mélangeant de nombreux styles artistiques, tout âge confondu, les animations en pixel art prenaient la relève. Passer après un medley de Egypte ancienne, Grèce Antique, impressionisme, pointillisme était une manière de plus de reconnaître le pixel art comme un courant artistique légitime… et aussi pour Disney de se l’approprier. Dans le jeu vidéo, tous ou presque s’y soumettent, car qui ne voudrait pas être de la fête ? Mario, Sonic, Street Fighter, Pac-Man, même Q*Bert est là pour encaisser quelques vannes. Même… allez, pas de spoilers. Et quand il n’y a pas les licences officielles, on fait en sorte que ça ressemble beaucoup à Halo ou à Mass Effect. Ralph est un film-monde avant tout pour les trentenaires nostalgiques, les hardis vingtenaires du néo-rétro et puis les gosses. De ce point de vue, on a l’impression de regarder enfin “ce” film que des générations de gamers attendaient après s’être enfilé des fadasseries comme Resident Evil. Ou pire. Avec Ralph, on est fier.
Mais le problème de Ralph, c’est qu’il en assez d’être un méchant. Un boss de fin de niveau. Malgré sa thérapie de groupe d’un fatalisme hilarant, il quitte son propre jeu, Fix-It Felix Jr, vieux jeu d’arcade rétro Donkey Kong style pour aller chercher le bonheur et la reconnaissance ailleurs. Panique, sans antagoniste, le jeu est défaillant. Il bogue et se voit menacer de se faire retirer du circuit. D’une mise en abîme du jeu vidéo, le récit retombe sur des rails connus: Ralph est un bourrin maladroit qui casse tout sur son passage mais qui heureusement va devenir meilleur au contact de Veneloppe, une rejeté d’un autre jeu vidéo.
Malheureusement, Wreck-it Ralph souffre du même “défaut” que la majorité des productions Pixar et Disney récentes. Et par défauts, il faut aussi comprendre que les Pixar restent largement au dessus du lot, malgré quelques bonnes surprises comme dragons. Mais ce défaut, c’est de balancer tout au début pour terminer d’une manière si conventionnelle qu’elle décevra. C’est vraiment une constante. Wall-E, mélancolique film post-apocalyptique muet se décharne dès qu’on commence à y parler. Up ! monte tout en haut des cimes de l’émotion, fait chialer dès ses 5 premières minutes pour finir avec des chiens qui pilotent des avions grâce à un os manche-à-balai. Même Brave / Rebelle nous fait miroiter un film féministo-viking avant de finir comme un buddy movie mère-fille. Une fois que Ralph atteint le monde de “Sugar Rush”, un clone de Mario Kart, la moitié du film devient si rose-bonbon qu’on en a mal aux dents. Si mièvre que toute la J-Pop du monde ne suffirait à décrire ces sucreries bubble-gum.
Attention, une heure de buddy-movie avec Ralph (merveilleux John C.Reilly, et François-Xavier Demaison en V.F, pas d’avis) et Veneloppe (Sarah Silverman) est une idée géniale. Mais ce n’est plus le film promis par le hub de jeux vidéo qui sert d’envers du décor. On ne voit finalement que trois jeux et beaucoup de kawaiiries roses bricolées en pain d’épice, comme pour s’excuser de plaire aussi aux filles. C’est dans cette partie qu’on entend des blagues via de douteux placements commerciaux sur les Mentos plongés dans le Coca Cola. Plus de retour en arrière, le schéma de la camaraderie des derniers succès de Disney se met en place et tout devient plus classique. “Sweet”, c’est le mot qui vient à l’esprit.
Trop d’AKB48 tue la JPOP. Néanmoins Ralph est de très loin le meilleur Disney de l’ère Lasseter, très Pixar dans sa manière de proposer un monde alternatif. C’est un film où Sonic fait la morale. Où Zangief se pose des questions sur le pourquoi de l’être méchant. Et c’est aussi un film sur un gros balaise qui casse tout en donnant des coups de poing. Fine by my book.
Brave, Snow White & the Huntsman, le féminisme déterre la hache de guerre
Sep 12th
L’été de la demoiselle pas si en détresse que ça: d’un côté, Brave, le Pixar des zilliards de polygones de rouquine qui, d’après le titre, va devoir se montrer rebelle mais pas courageuse. De l’autre, Kristen Stewart, la falote Snow White, qui va devoir se montrer courageuse aussi.
Deux héroïnes à chaque fois, deux armes différentes. L’arc contre l’épée.
Brave essaye de se vendre comme un film initiatique à la Miyazaki, alias le-parcours-d’une-jeune-fille-qui-va-découvrir-que-grandir-c’est-très-facile. En fait, il s’agit, et je me demande comment Pixar a pu garder cette information cachée aussi longtemps, d’un buddy movie mère-fille. Par le biais d’un twist forcément absurde, on passe de la comédie avé accents “Game of Thrones” à une histoire beaucoup plus conventionnelle. C’est d’ailleurs le point faible récurent de bons nombres de Pixar: le début d'”Up” balance tout, Incredibles et sa première moitié à la Fritz Lang ou encore Wall-E et sa proposition de monde sans humains, ces films sont toujours si. putain. de. bien. au début. Et avant qu’on s’en rende compte, on finit par avoir des chiens piloter des avions avec des os ou des cosmo-obèses de l’espace ou des trucs encore plus triviaux. Mais ce n’est pas le seul problème de Brave.
Cars 2 s’est fait pilonner par la critique, un mal acceptable quand on fait un demi-milliard de recettes. Enfin, pilonner sauf ici. Mais avec lui et Brave, Pixar est rentré dans l’ère de la vulnérabilité. Ils n’ont plus cette facilité incroyable que devaient maudire Dreamworks et les autres concurrents. Ils doivent lutter sur chaque personnage et chaque rebondissement. Difficile de faire un bon film cohérent quand on vire la réalisatrice pour divergence artistique en plein milieu. C’est déjà arrivé sur d’autres Pixars mais chez Brave, ça se voit.
L’originalité majeure de Brave, c’est de présenter une (jolie) jeune fille rebelle, qui rejette l’autorité de son père mais qui, c’est important, ne recherche pas l’amour.
Mais Disney est bien emmerdé par les récits pour filles. Ils restent populaires mais ne rapportent pas énormément en produits dérivés. Moins que Cars, that is. Alors après le coup “La princesse et la grenouille”, il fallait voir avec quelle maladresse ils ont géré Rapunzel/Raiponce renommé plusieurs fois et finalement sorti sous le nom de “Tangled” aux USA comme pour signifier aux petits garçons: “hé ho, vous pouvez venir le voir, celui-là !”. Car il parait que deux films orientés filles d’affilée, on évite, chez Disney…
Mais c’est comme le journalisme dicté par les “trends“, tu peux être certain que quelque chose ne tourne pas rond. Et comme si cela ne suffisait pas, l’autre grosse production de l’année pour Disney est un amer rappel de cette vérité. Je parle de “Princess of Mars”. Ou plutôt de celui qui s’est finalement appelé “John Carter“. Je ne sais pas si on peut en faire une statistique, mais il y a toujours eu un problème à chaque fois que le ciné hollywoodien a essayé de masculiniser des films qui n’en avaient pas besoin. “Quelle gueule aurait eu Brave avec Brenda Chapman à 100% du processus créatif” est sans doute le mystère le plus intéressant du dernier Pixar.
L’originalité de Snow White & the Huntsman, c’est de présenter une jeune fille, pas forcément rebelle. T’as vu, j’ai pas mis “jolie”, mais je vais parler aussi de cela. La fameuse Kristen Stewart. Enfin, si, dans l’histoire, elle est supposément plus belle que la reine incarnée par Charlize Theron. Mais ici la beauté, on ne le dit pas très fort dans le film, il faut tendre l’oreille, “elle vient du cœur”. Pas de bol, le seul pays où la beauté intérieure compte encore, c’est celui de Blanche Neige, ce qui, dans un sens, est parfaitement logique: c’est un conte de fées.
La reine est si méchante qu’elle croque des cœurs de lapin tout crus comme on mange des chips aux crevettes. L’histoire lui donne même une raison d’être en colère contre tous les hommes, de les manipuler et de leur extorquer leur royaume, ce qui fait de ce Snow White une espèce de “sorcelrape & vengeance” étrange. Je ne suis pas certain qu’il faille donner une raison à Ravenna (c’est son nom) d’être mauvaise, de faire des bukkake mystiques et de manger du lapin pour le breakfast, mais hé, comme ça, c’est plus clair.
Tous les autres éléments traditionnels, plus Disney que Grimm, passent à la trappe. Les sept nains ne comptent pas vraiment, l’un d’eux meurt d’ailleurs en cours de route dans une semi-indifférence. Il y a un passage éhontément pompé sur Mononoke Hime, avec des fées si bizarrement malsaines qu’on les croirait sorti d’Arthur et les Minimoys. La vraie attraction, c’est Thor, beau comme un dieu nordique et surtout qui fait tournoyer sa hache. Une hache qu’il tient comme un tonfa, le genre de détail que je trouve totalement badass. Si j’étais Blanche Neige, je tenterais un truc avec le mec Hemsworth, au pire tu pourras lever son petit frère (as seen in Expendables 2).
Sauf que c’est aussi un personnage néo-féministe, sous-entendu elle préfèrera enfiler une armure de 15 kilos sans entrainement préalable pour aller couper la tête de l’armée ennemie que de se poser avec un dude, même beau comme Thor. Le choix de la guerre, comme la Lady Marian de Robin Hood (de Ridley Scott), mais en moins ridicule.
Sans avoir ni vu ni lu Twilight, je sais ce qui s’y trouve, à savoir une métaphore poussive du sexe comme morsure, de l’amour platonique et de la pénitence par la reproduction. Et à tout hasard, j’ai googlé “Placenta vampire”, juste pour savoir si c’est si bête que ça.
La pauvre Kristen Stewart est obligée de supporter ce rôle trop grand pour elle avec tout ce qu’elle a dans le ventre. Tu sens qu’elle n’a pas grand chose, mais elle donne tout, comme ici pour Snow White. C’est peut-être un mélange de son teint blafard mais la pauvre est à la limite du featuring dans son propre film, à peine une ambiance. Le pire, c’est qu’elle joue tout le temps ce même rôle un peu inconsistant. Je suis méchant: quand elle n’incarne pas comme ici “la beauté virginale”, elle joue une toxico ou une pute aussi surement que son mec se faisait sonder les fesses pendant Cosmopolis (sont-ils ensembles ? Je ne sais). Elle ne mérite sans doute pas tout le mal qu’on dit sur elle, car elle ramène avec elle une aura bizarre. Le malaise est palpable, comme une gêne de l’ordre de l’ennui. A un moment, elle crie, désespérée: “How do I inspire ?” C’est un peu drôle venant d’elle. “Bah, j’sais pas, Kristen…”
Je ne sais pas comment elle y arrive, mais le film se tient. Le miracle se passe, l’actionneur avec Kristen Stewart comme héroïne fonctionne à peu près, essentiellement grâce à la Reine, superbe némesis, véritable méchante Disney IRL. Et puis un Huntsman endeuillé, un peu plouc mais beau comme un dieu asgardien.
L’intérêt de ces deux films tient dans le fait que les héroines n’ont pas l’amour comme objectif. A la fin, elles laissent ainsi la place à d’autres histoires, sans avoir le côté irritant d’un épisode final de série qui se sent obligé de tout casser, de résoudre tous les plots laissés en suspens. La paix est revenue mais hé, demain est un autre jour. Chacun de leur côté, Brave et Snow White ont proposé des versions particulières de Scarlet O’Hara, des héroïnes avec un arc ou une épée.
Drive (& Cars 2)
Nov 4th
Comme un western, un peu film de samouraï, beaucoup film des années 70, Michael Mann à fond les manettes et un chouia Cars (mais sans les voitures qui parlent), Drive se devait de me plaire.
Je t’ai déjà dit ici à quel point j’aime ce cinéma américain des années 70, racé, stoïque, aux trajectoires claires. C’est ce que j’aimais dans Cars 1 et n’ai pas vraiment retrouvé dans le 2. Hé ouais tu me vois arriver, je vais te parler d’autre chose avant de passer à Ryan Gosling avec des petits gants de conduite et un blouson griffé scorpion. Ce que je n’avais pas du tout prévu de faire, mais hé, comme ça vient, tant que ça me parait logique.
Cars 2 tente une audace étrange: transformer le héros en faire-valoir pour faire du truck maboul le centre d’intérêt. Et puis un angle James Bondien pour une scène d’ouverture démente. Mais Cars 2 vaut surtout le coup pour un moment sidérant, celle où toute l’écurie se déplace au Japon. 15 minutes les plus exactes que tu pourras jamais voir sur le Japon proche-futur et pré-explosion d’Akira, le genre de montages aux néons que tous les “Toqués de Tokyo” ne pourront jamais retranscrire aussi fidèlement. En déplaçant son intrigue des étendues américaines au mondialisme des courses auto, Cars 2 ne pouvait que diluer son intrigue et faire perdre ce côté 70’s qui en faisait le charme.
Mais puisqu’ici, j’aime essayer de capter ces moments de vérité, prise au fond du puis, mes petits moments d’émotion et de plaisir, Cars 2 fait une minute de vibrant hommage à Paul Newman dont le dernier rôle était précisément Doc Hudson dans Cars first. La scène se décale vers une étagère de trophées, ceux de Doc Hudson dont les radiateurs ont fini par lâcher. Et l’action, d’habitude si dynamique, toujours dans l’humour, se fige. Pixar et John Lasseter adressent là un hommage à Paul, et c’est probablement la micro-scène la plus touchante dans un film cette année. Je ne suis pas certain que les chaînes hertziennes en aient fait autant.
Et 5/5 pour l’hommage. I’m a sucker quand il s’agit des acteurs qui ont disparu. Ernest Borgnine a 94 ans et je sais pas comment je m’en remettrais quand… Anyway…
De Newman, de sa bogossité des années 70, on va passer à Drive (même si le summum de la classe de Newman, c’est plutôt les 60’s… ou 50’s comme disent les filles, pour “une chatte sur un toit brûlant”, toi-même-tu-sais)…
Bizarrement, Drive m’a permis de mieux apprécier certains Western… dont le dernier important n’est autre que Red Dead Redemption… Oui, un de mes jeux préférés de l’année dernière, celui-là même où l’on porte des jeunes filles attachées sur l’épaule… Au début, Marston se présente devant le fort où s’est retranché son Némésis et menace de l’en déloger. Il se fait logiquement aligner comme un lapin. Je trouvais le geste complètement stupide et prévisible, au point d’y voir une faiblesse d’écriture de Red Dead, surtout comparé à l’épilogue tout en justesse et en finesse.
Et pourtant, les cowboys obéissent à une espèce de code quasi-samouraï qui se décline de Red Dead à Ghost Dog, une sorte de confiance en eux et en leur propre démarche, surtout quand il casse les dents d’un méchant qui terrorise une femme innocente. Comme le personnage de Ryan Gosling, confiant, est invincible au volant de sa voiture, la nuit (car finalement il ne foire vraiment qu’en plein jour) alors qu’on ne lui connait pas de nom tout comme le rônin de Yojimbô. Comme dans tout western, il rêve “de se poser” et Carey Mulligan, d’une caresse sur le levier de vitesse lui laisse espérer exactement ça. Mais c’est au volant de sa caisse que Ryan Gosling prend toute la lumière (tellement meilleur acteur que dans l’horripilant Blue Valentine, une prestation qui transformerait presque à jamais en MEME. Et ces feux de croisement qui se reflète sur le pare-choc ou dans le retro, ce plaisir, c’est sans simplement parce que Michael Mann me manque.
Drive serait-il mon Cars 2011 ? Il y a tant de raisons pour moi d’aimer Drive que je pourrais continuer pendant des heures. Un trip qui me donne envie de rouler et de traverser une ville, en long en large, sans jamais chercher de place de stationnement, sentimental sans être émo-bitch, viril comme le petit bruit du frottement des gants en cuir sur le volant. Carré, affûté, racé. Le ciné que j’aime.


Top Films 2010
Jan 10th
Des centaines de critiques Airwolf. Les pires films aussi. Les autres “qu’j’ai pas eu le temps”. Mais le top du top sera :
Bonus track, d’abord : Inside Job et Armadillo, deux docu, l’un ultra pragmatique, l’autre méga esthétisant sur la guerre d’Afghanistan dans une caserne danoise.
10) Expendables
9) Poetry
8 ) Outrage
Même sans rien faire, Apatow produit le film le plus drôle et sexy de l’année.
6) A single man
T’aime Facebook ? Tu aimeras. T’aime pas Facebook ? T’aimeras aussi. Si tu n’aimes pas le Fincher de Benjamin Button ? Alors l’heure de la vengeance a sonné.
4) I wish I knew
Oké je triche, vu en avant-premièree. Jia Zhang Ke, best film robotics de l’année dernière. Difficile de faire un film plus beau que ça. Celui-là est moins fort, moins puissant que ses précédents (Still life, 24 City) mais quelle puissance quand même.
3) Toy Story 3
1) Mother

Les films Disney en 2010
Dec 23rd
Petit préambule. Pendant des années, j’ai vécu dans une aversion profonde de Disney, une haine entretenue par une détestation familiale dont seule l’inteligencia russe dont je suis issu a le secret (t’as pas idée). Et puis par ce qui me semblait être la médiocrité de leur production d’alors, l’époque irritante où n’importe quelle croûte sortant de leur studio était estampillée immédiatement “classique”. Et dernière couche, Disney savait me rendre si abject ce prisme déformant qui neutralisait (au sens propre) ses emprunts à la culture populaire mondiale une fois syphonné. (sidebar: bizarrement, cette détestation de l’adaptation a toujours été à géométrie variable pour les versions canines des classiques. Me souvenir du Holmes de Miyazaki m’est assez pénible tandis que la classe low-key des 3 Mousquetaires version clébards marche à merveille. Pire, même sans chien, Sous le Signe des mousquetaires avait l’outrecuidance d’ajouter un sidekick à d’Artagnan et de transformer Aramis en fille. Non mais sans déconner, Le-Japon. Fin de la sidebar). Bref, j’ai été entrainé comme un soldat à détester Disney, leurs plagiats patentés et leurs petits arrangements et trahisons.
Quadruple dose de Disney cette année. Non, quintuple si l’on compte EuroDisney que j’ai visité. Pour la première fois. 2010 on risque tout, t’as vu. Mais causons cinoche. Il y a eu Waking Sleeping Beauty, un documentaire qui raconte “les années noires du Disney modernes”. Un doc bien ficelé mais moins indispensable que cette Master class d’Ed Catmull (co-fondateur de Pixar) qui te raconte qu’ils ont foutu Toy Story 2 à la poubelle à peine quelques mois avant sa sortie pour le refaire entièrement. J’insiste, tu dois la voir, cette master class. Mais pour en revenir à Waking Sleeping Beauty, j’ai du mal à encaisser un doc qui part du principe que Black Cauldron (Taram) est un échec. Parce qu’il a fait moins d’argent que le film des Bisounours sorti la même année. Donc c’est un échec et voilà. À partir de cet acte manqué où a quand même officié toutes une nouvelle génération de gonz (plan de coupe sur Tim Burton, la gueule plus que jamais en mode étudiant d’art qui a raté une marche d’escalier, Lasseter, Bluth etc), Disney file les clefs de son studio d’anim à des mecs qui ne peuvent pas s’encadrer mais qui vont modifier de fond en comble la maison. Une lutte entre businessmen, dont le plus brillant va glamouriser le métier de l’animation, finira par aligner les records.
Sur tous les films qu’ils produisent au cours de cette décennie post Taram, je crois que je n’en sauverai pas un seul dans ma mémoire. Tous ces succès du new Disney (les adapt en tout cas) ont pour point commun de les twister de manière à me les rendre méprisable. J’ai entendu toutes les raisons (toutes valables hein, « c’est des récits pour les enfants », qu’on ne peut pas les montrer tel quel aux gosses … Et puis les frères Grimm, c’est trop noir pour les enfants et puis et puis…). Un monde avec des théières qui chantent, pourquoi pas mais pour le reste, sans une fin dramaturgique, la Belle et la Bête (mais aussi Pocahontas et tous les autres), c’est du canigou-ronron. Surtout quand la bête se change finalement en homme avec les traits non-charismatiques d’un Julian Assange. Random mec. Le pire, c’est sans doute Notre Dame de Paris qui prie Dieu et réussit à vaincre le méchant juge… Qui était un prêtre dans l’original (mais j’imagine qu’un juge, c’est tellement plus maléfique et facile à haïr qu’un prêtre ?). Et faire d’une œuvre profondément anticléricale un hymne au bon Dieu, c’est comme faire d’Elephant Man un pamphlet pour les bienfaits de la chirurgie esthétique. Et la petite sirène et ses crabes qui chantent du reggae… Ah et puis le pompon c’est toujours l’autocongratulation autour du Roi Lion qui fait toujours comme si de rien n’était. Le reconnaitre pour Disney, ce serait la mort… Et pourtant ce mensonge de plus donne au documentaire un angle purement business qui, lui, est passionnant. Mais aujourd’hui, j’ai essayé de faire comme si.
2010. C’est avec tout ce bagage que je vois le nu-Disney, la Princesse et la Grenouille, une héroïne noire qui lutte contre sa condition sociale de manière beaucoup plus contemporaine que Cendrillon. Sa famille est de la Nouvelle Orléans. Via une ellipse subtile, on nous explique que son père est mort à la guerre, “vu qu’il était au front comme la majorité des noirs”. Un moment de repentance si exécrée par Eric Zemmour et pourtant si salutaire. Et elle, son rêve, c’est d’ouvrir un resto. C’est tout. Vient un “prince” arrogant qui va se faire dépouiller par son majordome à la tête de Raffarin, poussé dans ce retour d’ascenseur social par un sorcier vaudou. Ça, c’est vraiment du bon background.
C’est assez étonnant de voir que les petites filles se sentent plus proches d’un personnage secondaire, une princesse blonde, et un peu tarte, une métaphore de la fille noblio-bourge un peu ronde qui ne rêve que de prince au mépris de tout risque de consanguinité, toujours à la limite de l’arrivisme social mais en fait une peste mais au bon cœur, sur l’air de “les riches vous comprennent aussi”. Mais depuis quelques temps la patte Pixar se mélange à Disney sous l’impulsion de Lasseter. Il y a deux éléments d’une maturité incroyable. Tout d’abord, il y a un crocodile trompettiste Louis, rendu mélancolique à cause de son impossibilité de se mélanger aux humains. Et puis il y a un personnage qui va mourir. Sans rire, on le voit à l’écran… Un peu comme Cassios dans Saint Seiya.
Mais c’est la première fois (je crois) qu’on va voir un rite funéraire, pas si éloigné de celui du Retour du jedi si ce n’est qu’ici, les Ewoks ne seront pas invités à la teuf.
 pour le Settei comme on dit en Japon, pour tout le background plein de sous-entendus assez fous.
pour le Settei comme on dit en Japon, pour tout le background plein de sous-entendus assez fous.
Avant d’embarquer pour le prochain Disney, il y a eu cette année Fantastic Mr Fox, le dernier Wes Anderson. Lui joue la continuité : c’est le même film que les anciens avec des acteurs, tournant toujours autour du thème de la structure familiale, de son éclatement et la manière qu’ont ses membres à s’étouffer les uns les autres pour mieux se retrouver. Ce qui est presque énervant, c’est cette attitude désinvolte globale à reprendre une histoire de Dahl, lui coller des musiques trendy (tu sais, cette agaçante playlist “qui veut te plaire”. Mais Mr Fox reste toujours dans une zone de confort assez frustrante, à l’image de ces renards qui, une fois en danger, bah ils creusent un terrier encore plus profond pour s’en sortir. Heureusement que la fin est assez jouissive, elle sauve un peu l’entreprise du sceau du film « gentil ».
Raiponce a commencé sur un grand malentendu : son titre. Annoncé un temps comme Razpuncel, le titre original du conte de Grimm, c’est finalement sous le nom de Tangled (« emmêlé » en v.o) que j’ai pris connaissance du dernier Disney. Il y a une raison du volte-face du studio : après la princesse et la grenouille, les pontes de Disney ne voulaient pas s’aliéner le public des garçons (that’s shônen to ya, kid). D’où le changement d’angle, mettant bien plus en avant Flynn (devineras-tu à qui s’adresse cet hommage appuyé ?). Ce switch est si débile qu’il évoque le changement de titre de The Great Mouse Detective / Basile dans un passage de Waking Sleeping Beauty, une modification devenue une vanne en interne car un mec s’est amusé à renommer tous les classiques du Studio de la même manière pour le LoL.
Raiponce 2.0 Disney custom. suit vaguement la trame originelle, une adapt libre qui ne posera problème à personne. C’est bien le parti pris de l’équipe : pas de vague, pas de message gauchiste soujacents comme dans la Princesse & la Grenouille. La seule véritable audace, ici, est d’utiliser de la 2D traditionnelle morphée en 3D. Kinda cool mais qui donne un peu l’impression de voir la réalité augmenté sur Ds : elle nous semblera bien ringarde d’ici quelques années.
Ah et ces lunettes 3D, je.n’en.peux.plus.

En fait, Raiponce a une qualité majeure à mes yeux : les animaux ne chantent pas.
Attention, je vais spoiler Toy Story 3. Et comme c’est un des films de l’année, je n’aimerai pas te faire ça. Attention donc, SPOILERS. C’est parti.
Mais s’il y a un gagnant cette année, c’est Toy Story 3. Pas certain que ça soit le meilleur Toy Story (donc encore moins le Best Pixar)… Il y a toujours des problèmes ici et là comme le rôle de Buzz, devenu sidekick transparent et dont on sent que Pixar ne sait pas trop quoi en faire. Un danseur de flamenco ? Pourquoi pas, au point où on est avec lui.
Tout le film est une redite des thèmes déjà tous cernés dans les précédents : la quête de l’amour dans les yeux de l’autre, la peur de la mort / de l’extinction, le courage, la crainte du changement de statut quo. Et puis dans le genre redite, il y a ces séquences d’évasion à ne plus savoir qu’en foutre (au moins 3 de plus rien que dans cet épisode, ça doit nous faire quoi, 8 au total sur 3 films ?) comme si Pixar avait quelque chose à prouver de ce côté là en ajoutant à chaque une ou deux références cinéphiles. Toy Story 3 a sans doute un des meilleurs némésis ever dans un film pour enfants. Sans rire, il a tout des plus grands, à savoir (la référence pour moi) Doctor Doom : une douleur originelle qui le fait basculer du coté du mal. Et qui refusera toute rédemption que tous les films Disney offrent systématiquement. Brillant.
Mais en fait, l’air de rien, Pixar touche à la grâce miyazakienne des plus belles années. Elle tient à cette scène assez lourde de métaphore (un four). Cette scène, c’est LA scène où les jouets se regardent avant le grand bond, avant de mourir. Cette grâce, c’est le silence. Le silence est un des éléments clefs des plus grandes scènes du cinema. La tension des gunfights, des sabres au clair de lune des samouraï, ne rien dire, c’est une technique si maîtrisée dans les films de Miyazaki où ses pics sont souvent muets. Là, les jouets se regardent et communiquent une dernière fois dans la langue que ne parlent plus les vivants. Pixar les a fait vivre dans l’angoisse, ils vivront désormais dans l’espoir.
Et donc sur ce silence, je crois que je n’ai plus rien à ajouter sur Disney en 2010.





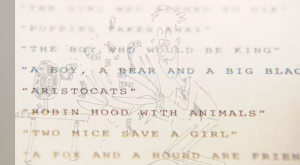
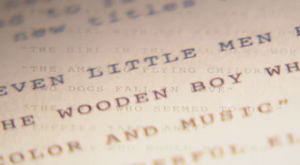


Com-Robot