Cinématographe
Be Kind Rewind
Jul 10th
Après avoir fait l’ultimate love comedy avec Eternal Sunshine et son meilleur boulot (Block party, le documentaire triomphal sur une fête de rue), Gondry est revenu au gentil et au rêve un peu naïf. On retrouve donc sa marque de fabrique habituelle, le carton et le papier crépon, l’amour du cheap travaillé et des bons sentiments par paquet de 12. Avec le titre VF, on comprend mieux de quoi on cause: “soyez sympas, rembobinez”. Paye ton titre qui tue. Be Kind & Rewind, donc, donne même un prétexte au bricolage de cours d’école. Jack Black le gars sympa fait équipe avec le mega sympa Mos Def et aide l’Immensément sympa Dany Glover à garder à flot son vidéoclub dont toutes les bandes ont été effacées. Du coup, ils se filment dans des parodies dignes du spectacle de fin d’année de CE2. Le problème, c’est que malgré un finish assez improbable mais intéressant et tout plein de clins d’œil de calibre « mdr cinéphile des années 80», c’est trop gentil, trop sucré. On retombe dans les constatations post chtits, il vaut mieux être cyniquement drôle que vaguement rigolo mais sincère. Bon sang, c’est si sucré sans même avoir de la quantité, sans même parler de qualité, celle qu’on est en droit d’attendre de Gondry. Au prochain, on s’énerve vraiment.
Note de  sur 5, principalement pour les quelques rires estampillés 80’s
sur 5, principalement pour les quelques rires estampillés 80’s
Le conte de Noël
Jun 25th
J’étais parti avec une envie sûre et certaine, celle de vouloir haïr le nouveau Desplechin. Déjà, Rois et Reines était un amoncellement de prétentions aggravées par la lecture des interviews accordées par le réa (le truc qui peut vous tuer un film, d’entendre parler de Woody Allen, Kurosawa, et puis de voir Rois et Reine). Il y avait aussi Emmanuel Devos en personnage principal (et un des reflexes salutaires de spectateur consistait à l’envie de la noyer tant elle y était horripilante). Conte de Noël s’annonçait comme pareil en pire. En plus la thématique « arguably » à chier de Noël nous donne en général des apartés comme dans la Bûche où chacun livre son traumatisme lié à la fête du petit Jésus qui, on le sait, n’est jamais aussi belle qu’on voudrait bien nous le faire croire.
Dans le mille ! Le dernier Desplechin, c’est tout ça. Amalric est là en mode Desplechin Custom, lunaire, foufou, totalement instable mais foncièrement attachant face à sa mère, Deneuve, qui campe une mère autoritaire et détestable. Elle joue exactement comme on pourrait s’attendre de la voir, une mère fouettarde un peu mégalo, une émulation inversée de la belle du seigneur, tendance Comtesse de Ségur. De toute sa fratrie, Henri/Amalric est le seul qui peut lui rallonger un peu la vie grâce à une greffe. Tout comme sa reum, sa sœur le hait de manière totalement irrationnelle, au point de demander devant un juge « son exil » de la famille. Tout contact avec elle lui était prohibé, jusqu’à ses providentielles festivités où il va un peu foutre le souk avec sa meuf providentielle (Emmanuelle Devos, même pas agaçante mais absolument égotrypé à fond). Le frère d’Amalric, joué par Melvil Poupeau (qui ressemble de plus en plus à Matthew Fox), essaye de faire tampon dans cette bouillabaisse de famille à laquelle s’ajoute les cousins, les maris, les enfants etc…
Ca cite, ça référence, ça parle en ellipse, ca théâtralise la moindre réplique à des cimes de non-naturel. Et pourtant, quelque part, dans ce melting-pot ultra caricatural rive gauche, boursoufflé de références bibliques, entrecoupé par des citations, d’auto-références conscientes d’elles-même, de tragédie grecques et de rap West coast, hé bien j’ai vachement aimé, ce qui m’ennuie car ce n’était pas du tout mon postulat de départ. Rois et reines s’écoutait parler alors que Conte de Noël est un vrai cri d’orgueil, une intéllo-pride à fond les ballons où tout devient signifiant sans y être pontifiant, avec des scènes tout simplement hallucinnante : Amalric qui lit sa lettre, Deneuve/Junon qui traduise l’espérance de vie en équation mathématique quand ce n’est pas pour dire qu’elle trouve sa belle-fille ringarde alors qu’elle est jouée… par Chiara Mastro, sa propre fille. Fuckn’ brillant, mais il faut y aller armé. Le jeu en vaut la chandelle
Paris
Jun 23rd
Malgré son titre ambitieux, Paris est à Clapich ce que David Martinon est à Neuilly : une greffe qui n’a pas pris. Le film choral, c’est devenu le genre atroce du cinéma français, où les acteurs viennent cachetonner en cabotinant leur propre style. C’est toujours un peu toujours les mêmes que l’on voit, mais là, ce n’est même pas eux le problème. Sauf pour Karin Viard dont la prestation de 4 minutes est proche de l’insoutenable. Duris se contente de faire le béat dépressif en regardant Paris genre « c’est beau, une ville qui bouge ». Luchini nous fait son meilleur rôle de lui-même, c’est-à-dire Tout le monde en parle 2005 et On n’est pas couché 2007. Son very best, le meilleur cru, il est allé au bout de son personnage comme Bacri dans le rôle de grincheux. C’est dingue, ça, c’est des mecs qu’on aurait tendance à adorer, vraiment, et à force de ressasser la même thématique, de se faire proposer les mêmes rôles, on n’en peut juste plus . Même Dupontel joue encore une fois ce qu’il fait de mieux, c’est-à-dire « le mec au bord de la crise et qui menace d’exploser à tout moment » et excelle. Ca lui permet de répéter son prochain rôle du même genre, à la “2 jours à tuer” (j’y reviendrais). Certes, il ne peut pas sauver un film comme on a pu le voir dans l’immonde « Fauteuil d’orchestre », mais he delivers. Non, ce qui pose problème, c’est ce cinéma béat, content de lui-même qui aligne des poncifs pénibles en les martelant. C’est à peu près aussi pertinent que la morale à la fin d’un épisode d’une série des années 80 et « le sourire du jour » à la fin du JT. Du bonheur prédécoupé pour un soufflé qui s’est dégonflé.
There will be blood
Jun 21st
Attention, vingt premières minutes sublimes. Zéro dialogue, musiques à vrai dire “je ne sais plus”, et Daniel Day Lewis qui acte à mort le non-événement, fouillant inlassablement le sol hostile de l’ouest américain. Le plan où il rampe, solitaire, face au désert, m’en a filé pour mes thunes, merci Paul Thomas Anderson. Ensuite on rentre dans un cycle de la folie. Day la joue (la folie) face caméra, sur une zique assourdissante qui ferait passer une descente de valkyrie pour un pique nique à Paris Plage. Même quand il se passe fuckn’ rien, la sono est foutue à fond, à tel point que ça rappelle les boites de nuit assourdissantes où l’on aimerait bien discuter avec la fille à la bouche concupiscente accoudée au bar mais bon sang, pas moyen.
Maintenant que la perf’ (forcément brillante, check) de Day Lewis est entendue, il reste un film type « Rise and Fall », sauf que le fall ne vient pas. L’ascension implacable du magnat du pétrole accompagné par son môme inéluctable est bizarrement équilibrée : les scènes grandioses sont intercalées par d’autres totalement granguignolesque. Une discussion méga importante sur son enfance ou avec son môme sera contrebalancée par une où Day est ivre mort et gueule en faisant des contorsions du visage (au mieux) et des mouvements de bras zarbi comme lorsqu’il est à jeun. Impossible à savoir avec lui, he’s maaaad. Du coup, le résultat repose vraiment sur sa propre sensibilité à la hype, tant le film se pose sur un fil tendu entre profondeur et ridicule, que PTA ne se gène pas pour franchir consciemment lors d’une scène finale ubuesque, ce qui est con car elle suit elle même un climax freudien absolument sublimes. Bref, sensibilité à la hype ou alors aux testostérones du bogosse qui feront le reste. Hé, ça a pas mal marché pour Iron Man.
Useless
Jun 19th
Wuyong (Useless)
Plastiquement brillant, la moindre scène du quotidien filmée par Jia Zhang Ke devient profonde et pleine de sens. Il sublime tout côté glauque et la rugosité ambiante pour lui donner une dimension artistique assez incroyable. Ici, il s’attaque à l’industrie du textile/fringues sous trois angles, le riche, le pauvre, et le mega pauvre (la France, la nouvelle Chine et l’ancienne). C’est moins glamour que les reportages simili « poil à gratter » made in Canal+ et autres entrefilets caustiques sur le monde de la mode proposés par les JT lors des collections automne-hiver. Après avoir rendu de manière absolument incroyable le labeur d’un démolisseur de maisons chinois sous 45° au soleil (le sublime Still Life où le moindre caillou, les moindres souffles de lassitudes de vie devenaient « un chantier à fleur de peau »), il retranscrit ici parfaitement l’acte robotique lié au travail du textile, à la fois désincarné et moteur de toute une économie et d’une dynamique de vie. Tout cela sans jugement (on n’est pas dans Zone Interdite), ni analyse, y’a pas marqué « C’est dans l’air ». Quoiqu’il en soit, Jia Zhang Ke est toujours aussi fascinant.
Astérix 3, Chtits, Disco, le triforce de la comédie française
Jun 15th

Après avoir évité le genre dans son intégralité en 2007, j’ai choisi de faire une grosse injection de cette catégorie la plus indéfendable du cinéma français actuel, à savoir la comédie, la bonne, la grasse, celle qui est vendue à longueur de plateaux promo avec “les stars de la télé que tu aimes“. Mais évoquer simplement ces grands moments de fou rire hors contexte, sans recul, ne veut rien dire. Il fallait faire une étude comparée, une triangulation de cette réussite à la française. Voici donc Astérix Vs Disco Vs les Ch’tis, le rendez-vous de la grosse poilade à la française.
Les 3 films ont comme point commun de ne m’avoir fait rire que nerveusement, comme une toux réprimée qui éclaterait d’autant plus fort qu’on y a résisté pendant 5 minutes. Comme un fou rire dans un cimetière, le truc impressionnant mais flippant à voir. Mais entrons dans les détails.
Les ch’tis commence vraiment pas mal, en petit concentré d’intensité humaine à la Poste que tous le monde connait vu qu’on est tous déjà allé chercher un colis soit parce que le mec s’est gouré à la “n’habite pas à l’adresse indiquée”, soit parce qu’il a la flemme de monter un étage voire de passer la porte d’entrée. La Poste, l’entité idéale pour briser vos bonnes résolutions de No More Hate pour 2008. Kad, c’est la star de la télé que tu aimes de ce film. Il tente de gruger le système en se faisant passer pour un handicapé, histoire de se faire attribuer une place au soleil. Manque de bol, le pitre se fait pincer et se fait envoyer dans ce qui lui parait être le trou du cul du monde, le nord. Ca aurait pu être pire, du genre Berne en Suisse, mais bon, va pour le nord. On tient là les bases de ce qui aurait pu être une fabuleuse comédie sociale sur le monde de la Poste (et dieu seul sait qu’il y a des choses à dire sur le sujet) ou même sur le langage (les parties les plus marrantes de la bande annonce, malhabilement placées au début du film ce qui est mauvais signe). Et finalement on tombe sur un autre schéma bien connu, celui du buddy comedy de base. En gros, Kad apprends à parler le chtit à la vitesse de la lumière, devient vite pote avec Danny Boon et puis ce sera la tristesse au moment de partir après un moment de crise. L’argument qui revient constamment pour justifier ce film d’une neutralité bayrouesque et de son succès post-factum, c’est « la sincérité » de l’entreprise, sensée lui donner une street cred’ supplémentaire. Malheureusement, ça ne fait pas rire plus que ça. Tant qu’à faire, je préfère un film cynique et drôle à un produit gentil et inoffensif comme du Palmolive. Attention, ne dites pas que vous n’aimez pas, vous vous exposez aux « allez quoi, c’est marrant » ou aux « vraiment ? T’aimes rien ou quoi ? ».
Disco est un tout autre problème. On se demande vraiment quels sont les tenants et les aboutissants de ce film clonant l’irritant Camping. Ici, la star de la télé que tu aimes, c’est Frank Dubosc. Il nous rejoue ici l’unique rôle de sa vie, le vieux bellâtre lifté, gamin rêveur perdu entre les bisounours et Casimir, si distant de la réalité qu’on a pitié pour lui autant que son personnage. On peut citer son immortelle quote « Benco ? Miam miam » de Camping, et comme dirait Rohff, “Quand t’as dit ça, t’as plus peur de personne”. Cet espèce de jusqu’au boutisme artistique un peu suicidaire n’est pas sans rappeler « Joseph Lubsky », pseudonyme de Patrick Sebastien qui, selon ses propres termes, « est allé jusqu’aux portes de la schizophrénie ». Sans rire… Mais Disco est une œuvre collective digne de Lynch. No shit. Entendons nous bien : pas un rire ne s’échappe de la salle si ce n’est celui de l’incompréhension d’une œuvre qui le dépasse ou alors une exclamation nerveuse. Le coup du cimetière susmentionné, là. Si c’est un film comique, c’est un brillant échec, à la limite de la ruine romantique du XIXème siècle. Mais dans la catégorie « autre », qui va du documentaire à la “Tragédie Grecque tournée à la DV”, c’est surpuissant. Aucun acteur ne semble jouer dans le même film. Ils déclament leurs lignes de dialogues comme du Ionesco ou du Beckett avec un poil de cynisme de ceux qui n’aiment pas les gens. Depardieu, on ne sait pas ce qu’il fout là. Dans ce petit théâtre de l’absurde, Emmanuelle Béart semble être le seul lien à la réalité, la seule qui renvoie un peu la balle aux autres qui jouent seul tout. En bon ovni dramatique, on peut être certain qu’un Disco signé par Kitano ou par un coréen aurait touché au génie décalé. Enfin, la marques des grands films : Francis Lalane fait un caméo, jouant son propre rôle, à fond dans l’autodérision.
Point de bizarrerie discophile ni sincérité chtites pour Astérix aux jeux olympiques. Le moteur de la megaprod est tellement une hypothèse qu’on en pleurerait. On aime tous Goscinny. Tout le monde s’accorde à trouver Udezo seul complètement nul, surtout depuis le suicidaire dernier album (le suicide, constante comique française, voire Disco). Heureusement Forestier et Langmann ont tout compris à la finesse culturelle et populaire de Gosc’. Ca commence donc par un florilège de chute. 3 ou 4 en 10mn. Et là, le fan devrait heureux car on touche vraiment à la substantifique moelle d’Astérix. C’est à peine si on remarque l’absence de la peau de banane, élément indispensable de causticité mais toujours sans entrer dans l’irrévérence politique . Ah Uderzo a été bien inspiré de refuser à Jugnot et au Splendid de faire un nouveau Astérix. Si vous aimez les stars de la télé que tu aimes, ce flim est pour vous. Il n’y a que ça, de l’intouchable aux plus modestes « bon clients des talk show de la télé que tu aimes », une vraie dream team réuni pour ce projet. On se croirait sur un plateau de Fogiel ou d’Ardisson. Et si t’en as pas encore assez, t’as Alice (youhou), Schumacker, Jean Todd qui a surement pécho une ristourne pour une Ferrari pour Uderzo. Mais revenons aux chutes. La première est signé Stéphane Rousseau. Je ne le connaissais pas vraiment, mais il parait qu’il est huge. Dès la toute première scène du film, il perd son équilibre un peu sans raison et laisse tomber son cul dans l’eau.

Ensuite il tombe tout seul, une fois, de manière incompréhensible, comme un narcoleptique éveillé.

Et comme on est dans l’humour de qualité, il se fait foutre à la porte, prestation qui n’est pas sans rappeler l’immortel Angel-A de Besson.

Puis Poolvorde se casse la gueule aussi. Lui, c’est plus une chute naturelle et pas du tout causé par le drame de l’alcool, l’ingrédient indispensable et avoué pour tenir le coup sur ces tournages à structure familiale..

Une fois cette cascade de vannes, véritable menu best of des 20 dernières années d’Astérix par Uderzo, on bascule sur Delon qui joue “à la Dubosc”, mais avec des rides. Le césar amoureux de lui-même, balance deux trois blagues wikipédia pas très drôles (« je suis un guépard, un samouraï, (…) je n’ai peur ni de Rocco ni de ses frères etc »). Et puis comme ce n’était pas assez drôle, il lève les doigts en signe de victoire. Subtile direction d’acteur. Peut-être une référence à l’immortel Chirac du bêbête show « Ecoutez-crac-crac-ta-gueule ».
 (moment de cinéma grandiose désormais immortalisé dans le bandeau aléatoire qui surplombe Kamui Robotics, check)
(moment de cinéma grandiose désormais immortalisé dans le bandeau aléatoire qui surplombe Kamui Robotics, check)
A ce moment là de l’analyse, il faut préciser que le film a été coécrit par deux des plus mauvais auteurs des guignols, ceux d’après l’ère Delepine et Hallin. Précision aussi concernant ce visionnage digne d’un laboratoire pharmaceutique: tout s’est fait sur un DVD russe, avec comparaison avec le divix français pour sentir les frémissements de rire dans la salle, qui évidemment ne s’entendaient pas des masses. Sauf une fois, quand Depardieu fait « youhou », genre Cyrano. Vers les 3/4 du film, ne manquez pas cette cinéphilie appuyée. Roulant sa bosse jusqu’au bout, Astérix 3 va sombrer dans ses derniers instants. Oui, pire encore que tout le film réuni. Débarque Jamel Debouze Theuriau qui n’était pas là de tout ce chouette film. Il s’embarque dans un tunnel d’une quinzaine de minutes avec d’autres guests. Il va tenter de dribler Zizou, passer Tonipi etc. Plus-value comique proche du néant, on admirera la vacuité de ce moment d’un cynisme fou, où toute narration est abandonnée. Le Zéro absolu de cette raison d’être éclabousse tout le film qui déjà a du mal à se justifier tout court. On n’a jamais vu ça. Ils croyaient sauver le cinéma français avec ses stars cochonou et ses millions d’investissements alors que ça pèse rien sur sa balance. Seul point positif quand même, Christian Clavier est ‘achement mieux ici que dans les deux premiers. Et enfin, la marques des grands films : Francis Lalane fait un caméo, jouant son propre rôle, à fond dans l’autodérision.
On en est à choisir le moins pire. Je ne pousserais pas l’expérience plus loin, trop risqué.
Juno
May 21st
Vous avez toujours rêvé de voir Daria en live ? Juno, c’est exactement ça, mais plus encore. Juno, “copine qu’on rêve tous d’avoir au bahut” est sympa, cool, smart, plutôt mignonne, avec un humour à froid super cassant. Bref tout est là pour faire une comédie à la Punkie Brewster mais avec le ton Daria. Le film se gargarise de son label « indé » qui commence après disparition du gros logo de la 20th Century Fox au début (le réa, c’est juste le fils d’Ivan Reitman, l’odeur de souffre du ciné alternatif se fait intense !). Ce label street cred’ suggère en gros que les dialogues seront ciselés dans la pop culture et enrubannés d’une bande son hypé. Point de départ de l’intrigue, Juno va tomber enceinte mais décide de céder le mouflet à un couple qui ne peut pas en avoir. Mais le risque, quand on fait jouer des mômes (ou ce qui ressemble à des gosses, car ils ont tous un peu 20 ans), c’est de les transformer en petit singe savant qui balancent leurs répliques comme des petites marionnettes.
Juno nous balance son flow totalement artificiel de cynisme comme un singe savant , Parfaitement, Juno, c’est César 12 ans et demi, mais en version pop rock qui écoute de la musique cool. Elle maîtrise la déclinologie adulte aussi bien que 60 millions de consommateurs mais son numéro de séduction (car c’est ça le problème, c’est qu’elle te regarde dans les yeux en te disant « Aime moi, je suis cool ») ne marche pas sur moi. Même si l’ombre de la sexualité plane (après tout, elle est enceinte), on reste dans une problématique superficiellement cul, à tourner autour du pot. En fait, plus que les dialogues sur-écrit, c’est la mousse super conventionnelle et moralo-compatible avec le monde entier, de Keith Richards à Mahmoud Ahmadinejad en passant par David Douillet, un message qui ne déplairait pas au pasteur père et héros de la série « 7 à la maison » et qui finit par enclencher l’alerte “Arnaque”.
Cloverfield
May 12th
Les gens s’étaient passés le mot : « fais gaffe, tu vas gerber » « c’est irregardable » « ça fout la migraine ». Ouais bah ça doit être comme les gens malades dans le train quand ils sont assis dans le sens inverse de la marche: jamais compris. Cloverfield, c’est du streum géant qu’on voit en fait à peine, dont l’absence même devient un des gimmicks principaux. Bref, un film catastrophe classique.
Jean-Louis est heureux, il s’apprête à partir loin, très loin et donne une fête pour son départ dans son luxueux loft de New York. C’est le bobo-ys next door. Tout le monde est là, son ex, Justine, son frère Jean-Baptiste et même Jean-François, son pote un peu boulet qui va tenir la caméra pour faire un making of de la sauterie. Mais paf, tout explose, des trucs tombent du ciel, c’est la dissolution de New York. Tout est détruit par le fameux monstre géant timide comme c’est pas permis, pendant que Jean-Francois tourne le tout, rajoutant ses petits commentaires éberlués (mais sans jamais dire « fuck » ou des gros mots, ce qui rendrait le tout encore un peu plus naturel, toujours poli le mec). Du coup, ils vont partir à la recherche de Justine. Classique mais la sauce prends bien, on est vachement impliqué. Et c’est parti, entraîné par la caméra à l’épaule quasi invulnérable, alimenté par sa batterie immortelle (enfin si, on change les piles mais c’est pour faire staïle, comme quand les chinois rechargent dans les films de John Woo). Mais en même temps, c’est à ce genre de détail rationnel qu’on oublie qu’il y a un gros lézard qui est en train de transformer la ville en steak tartare. Ouais, on a beau voir Superman soulever la croute terrestre, détourner des missiles atomiques ou modifier le sens de rotation de la planète pour remonter dans le temps, mais c’est quand il arrache la porte de Lois Lane d’une main que la salle fait wow. Une forme de loi de proximité cinématographique. C’est dans cet équilibre entre réalisme et streumicide que l’alchimie se fait.
Le problème, c’est que la référence ultime du genre est désormais coréenne. A côté de ça, l’efficacité léchée de Cloverfield dégage une énergie tellement mono expressive dans son récit que la comparaison se fait obligatoirement, mais en sa défaveur. Du coup, on a un film entre deux chaises: pas assez intello pour faire la nique au coréen, mais pas assez pop pour sortir une ligne de jouets cools. Pour peu qu’on ne s’attende pas à voir Godzilla en train de soulever des immeubles pour s’en faire des cure-dents et plus à des gens lambda de type Lorànt Deutsch, des newyorkais qui crient au moindre danger, c’est de l’entertainement de qualité.
Note finale:

Mais ce qui manque à Cloverfield: une gamme de jouets charismatiques.

Genre ça.
Iron Man
May 9th



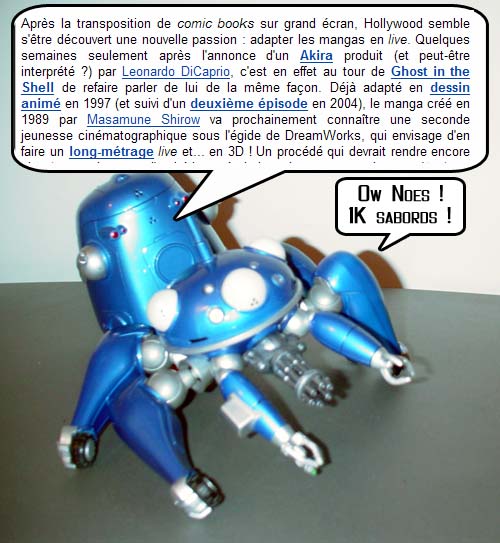
« You gotta believe ». C’est le mantra de Richard Donner qui alpaguant Christopher Reeves, harnaché en équilibre sur le tournage de Superman, premier du nom. Bizarrement, les deux-trois meilleurs films de super-héros de l’humanité (Superman, donc, et Rocketeer*) mettent toujours en scène des mecs qui volent. Bon signe pour Iron Man.
Aussi loin que mes souvenirs me portent, j’ai toujours aimé Iron Man. Passionnément. J’ai noirci des centaines de feuilles quadrillées en cours de math de 6ème C en tentant de concevoir une armure qui pourrait fonctionner. J’aime plus que de raison l’époque Romita. J’idolâtre encore plus le run formidable de Layton et Michelinie. Un petit détail justement datant de cette période-là : à un moment, Stark se fait faire une manucure juste histoire de draguer une belle nana, ce qui lui vaut des vannes de Rhodey. Léger mais sérieux à la fois. Note : il a beaucoup « changé » en comics aujourd’hui. Récemment, il passait surtout ses week-end à envoyer ses copains super-héros dans des camps de concentration cosmiques, pour la déconne, ce qui peut le ranger dans la case « uncool »). L’original cabotine, mais avec un grand recul sur lui-même, à la limite du Bruce Wayne, le génie technologique en plus. Ce n’est pas un mec complexe, on peut le comprendre en une histoire. Robert Downey Jr (formidable dans Für, intriguant mais trop bref dans Zodiac) le joue exactement comme il doit l’être, à la drôle mais sans perdre son sérieux d’acteur. Il ne se fait pas un trip à la Timothy Dalton (Licence to Kill) du genre « j’ai joué Shakespeare, je peux quand même faire de la bédé pour mômes ». Les adaptations de bédé, c’est un peu comme la lutte interne du PS, chacun pense voir clair dans la direction à prendre pour un parti qui n’existe plus que pour essayer de rester en Ligue 1. Le parti pris de Favreau, c’est d’aller droit au but sans faire de relectures qui, en général, ont pourri les précédentes adaptations. Pas de méta-références, de vannes LOL qui se moquent du genre (à la X-Men 1 ou Spider-Man, avec l’inévitable clin d’œil démago de connivence avec le public), Iron Man ze movie est vraiment fidèle, dans ses très grandes lignes au comics original. Pas non plus de relectures psy (« Tu vois, Hulk, c’est finalement qu’une vision postfreudienne des rayons gamma Œdipien »), ni de pamphlets (« Les mutants, ce peuple opprimé », sans parler des lourdes métaphores de Superman Returns, toujours de l’indigeste Singer). Pas besoin de défaire des idées qui ne sont pas cassées, comme ne s’était pas privé de faire les Fantastic Four 1&2. Il y a certes pas mal de lectures possibles dans l’attitude de Stark qui découvre, tel un ado son premier téléfilm érotique, les méfaits de ses armes dans le monde ce qui le pousse à changer de fusil d’épaule. Tout ça, c’était déjà dans le génialissime arc Armor Wars.

Favreau prend même des risques en passant pas mal de temps, plus que de raison, à expliquer les personnages, à tel point qu’il reste vraiment peu de combats (D’ailleurs le jeu vidéo est lamentable). On quitte la règle canonique qui stipule qu’un blockbuster d’aujourd’hui doit commencer par une scène de baston « dans ta face » pour bien tester ton Full HD et ton 5.1 de bourgeois. Les effets spéciaux font tous pour normaliser une technologie de ‘ouf, mais sans trop forcer la main comme les Transformers qui jouent à cache-cache. D’ailleurs, le moment le plus improbable, c’est quand Gwyneth Paltrow (Pepper) se tape un sprint en talons hauts. Autre risque supplémentaire : le premier Némésis est un doppelganger, un simple clone d’Iron Man. Imaginez Venom en ouverture de Spider-Man 1 ? Ou la baston des Supermen dans le premier film ? Heureusement Jeff Bridges est bon même s’il campe un personnage radicalement différent de l’original, plus en badass. C’est d’ailleurs une des rares films du genre où le casting se tienne vraiment. Un détail qui fait qu’il se passe quelque chose, c’est quand on reçoit mail, SMS vous disant « mec, je suis hétéro mais Robby Downy c’est quand il veut ! » ou encore « Je n’ai pas eu envie de noyer Gwyneth, c’est fou ! ». Bah oui, c’est fou, mais le Hollywood-verse choisit aujourd’hui des acteurs talentueux ET qui ressemblent physiquement aux personnages originaux. Tout ne se décident plus sur une disponibilité d’emploi du temps… A moins que…
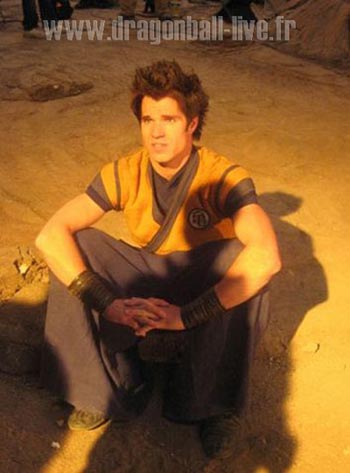 jeez
jeez
En général, un projet de film de super-héros, ça se traine pendant 20 ans. 20 ans qu’on entend des trucs infâmes, que Tom Cruise a racheté les scripts pour le jouer, et puis que Selleck, l’autre Tom, a été casté pour jouer Stark (oui, vous voyez, il a une moustache). Sans parler des rumeurs avec Nicolas Cage, jamais très loin quand il s’agit de comics. 20 ans et plus pour monter Watchmen ou Spider-Man. Du coup, c’est presque comme une bénédiction de voir Sexadelicious Downey incarner Stark, de voir un Rhodey qui se tient ou une Pepper gentiment cruche. Le coup de génie fanboy aura été de caser 3 armures d’un coup et pas que pour sortir de superbes jouets. Elles ont été adaptées aux contingences modernes. Pas d’armure polarisée. C’est un choix judicieux qui rappelle le Bat-char d’assaut, suite logique des Batmobiles adaptés à un monde embouteillé par les vélibs et les couloirs de bus. Même dans son mecha design « conventionnel », Iron Man impressionne. Le jet privé de Stark est tout simplement sublime. Ses robots qui l’aident à gérer son atelier et qui coupent le gaz en été parce que GDF n’arrête pas d’augmenter ses tarifs en cabotinant gentiment avec Downey sont tops !
Evidemment, il reste pas mal de trucs en suspens pour l’inévitable suite. Comment intégrer le Mandarin ou Fin Fan Foom dans la situation géopolitique de l’Afghanisthan ? La suite, l’étape casse-gueule.
Au final, superbe adaptation d’illustré qui mérite bien ses 
- Rocketeer. Sérieusement. Enfin, il y a aussi Master of The Universe qui vaut son pesant de cacahuètes pour les amateurs de Kirby.
Un mot sur la fin, donc tu zappes. L’idée d’outer Stark à la fin. Mouif, une pilule assez difficile à avaler pour un fan de l’Iron Man pré-2000 mais vendue assez bien par Downey Jr. Par contre, la surprise de Nick Fury « motherfucka » après le générique final, c’est non !


 Follow
Follow

Com-Robot